Silvia Federici (Parme, 1942) est une auteure reconnue en plus d’être une activiste italo-américaine. Professeure à la Hofstra University de New York, elle est une militante féministe convaincue depuis 1960 et fut une des principales animatrices des débats internationaux sur la condition et la rémunération du travail domestique qui ont marqué les années 1980. Elle a travaillé plusieurs années comme professeur au Nigeria. La singularité de sa pensée réside dans le fait qu’elle refuse catégoriquement le fait que le patriarcat, le travail domestique et l’inégalité des femmes soient situés hors du capitalisme et pour ainsi dire exempts de toute critique.
Luis Martinez Andrade : Comment le concept de communalité est-il appréhendé dans le Sud Global et plus spécifiquement en Amérique latine ? Qu’est ce qui le différencie de la notion du « common » proposée par Antonio Negri et Michael Hardt, et du « commun » développé dans le monde français par Pierre Dardot et Christian Laval ?
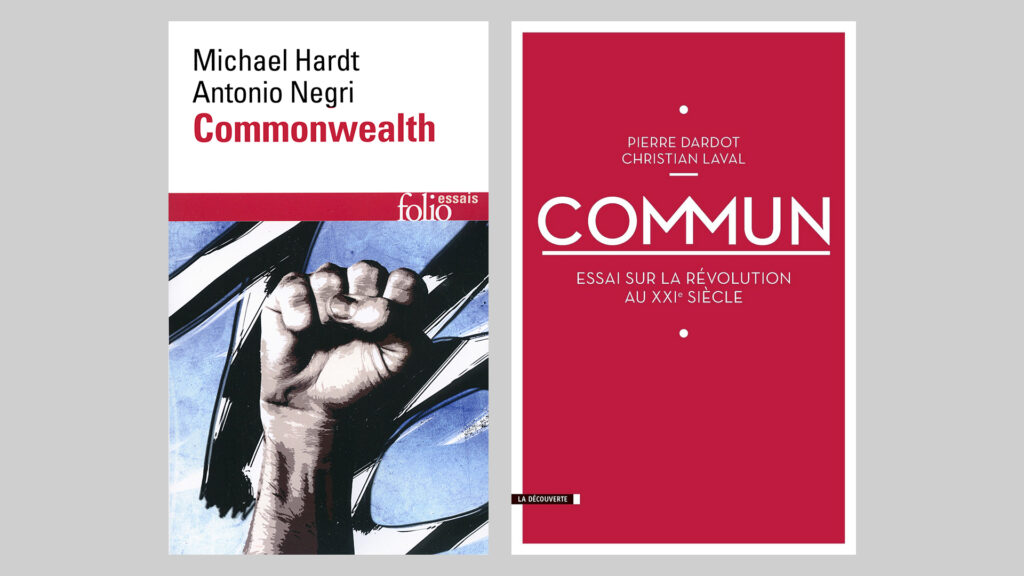
Avec le contrôle de la terre et du territoire, les communautés indigènes exercent des formes d’autogouvernement et cela transparaît dans la manière de prendre des décisions tout autant que pour déterminer qui est membre de la communauté et qui n’en fait pas partie. Par exemple, le tequio (travail collectif que tout membre de la communauté doit réaliser en son sein) n’est pas quelque chose de volontaire, c’est bel et bien une pratique obligatoire. Autre exemple éloquent de pratiques intrinsèquement liées à la communauté dont parle Gladys Tzul Tzul : si l’on ne participe pas au travail collectif, à l’effort partagé, alors il est impossible d’envisager de parler lors d’une assemblée. Ce travail est essentiel dans la communauté, car il permet justement la reproduction de la force de travail et d’une conscience, d’un vécu partagés.
Le travail collectif crée des liens, tisse des relations communautaires très fortes et par ce biais, les gens se rendent compte du principe de « réciprocité » : ton bien-être dépend du bien-être d’autrui. Les rituels (comme les fêtes) sont fondamentaux, puisque ce sont des moments de re-signification de l’identité, de l’engagement pour l’unité. D’un autre côté, le rôle de l’assemblée est primordial. L’assemblée est un lieu d’autorité, étant donné que c’est l’espace à partir duquel se prennent les décisions de manière collective. Gladys Tzul Tzul propose une analyse très intéressante, car elle montre comment sur différents lieux (comme à Totonicapan) les gens partagent la terre, le travail, et la reproduction de la communauté s’organise autour de la ville, de la gestion de l’eau, de la maintenance faite sur l’irrigation ou le travail au champ. Ce sont un ensemble de préoccupations collectives donnant du sens et une signification à ce que nous considérons être la politique. C’est précisément là qu’émerge l’organisation de la reproduction.
Le travail de Gladys Tzul Tzul fait notamment écho à ce que j’ai pu évoquer en d’autres circonstances. C’est une chercheuse qu’il faut suivre de près. Elle vient de publier son second livre et j’ai pu constater comment les autorités indigènes ont reconnu ses efforts et son travail. De fait, je dois mentionner que durant le Congrès international de la Communalité, le « commun » n’est même pas évoqué. C’est plus de l’ordre du ressenti et des aspects cognitifs ou sensibles que la raison tolère. Au sein du système de la communauté indigène, il existe un nombre de valeurs importantes, et cela impacte le reste des mouvements zapatistes, mais aussi féministes.

En Amérique latine, dans les réseaux de femmes paysannes, indigènes et urbaines, le féminisme populaire défend la terre, le territoire, et donne une signification particulière à la corporalité, à un corps-territoire. Malgré le fait qu’il existe un conflit sur la notion de genre dans l’indigénisme, des femmes comme Gladys Tzul Tzul s’attachent à démontrer les tensions qui existent à l’intérieur du monde indigène, notamment autour de l’héritage et de la terre pour les hommes. Par exemple, dans le cas d’une femme qui se marie en dehors de son ethnie, le fils perd le droit d’hériter la terre. En ce qui concerne la mémoire, je dois mentionner le fait que c’est un aspect central de la communalité indigène. Par exemple, les féministes latino-américaines ont mis en avant le fait qu’il existe une solidarité avec les morts, avec ceux qui ont lutté auparavant. Cela permet de donner de l’allant, pour continuer à aller de l’avant, poursuivre la bataille, malgré les morts, les blessures, l’enfermement. Cette mémoire collective est une source d’inspiration immanente, un encouragement à transparaître sur le bien commun.
Pour autant, je crois qu’il existe une différence fondamentale, car le concept de commun (the commun) qui s’est développé en Europe et aux États-Unis a été influencé par l’indigénisme. Le zapatisme a marqué son époque, avec la fameuse « rencontre intergalactique » qui est aussi une manière de proposer une alternative au capitalisme en entravant le phénomène de privatisation. Ces privatisations se sont par ailleurs répandues dans toutes les facettes de la vie quotidienne et que l’on en ait conscience ou pas, cela perturbe, abîme et avilit nos corps.
Le patrimoine génétique ne se privatise-t-il pas allégrement ? Comment s’exprime ce concept de « commun » ? N’est-ce pas là l’expression d’une homogénéité, l’homogénéité éthique ou l’homogénéité politique – comme on se plairait à reconnaître une forme d’autogouvernement – ou une aspiration à une société gouvernée par une autre logique que celle qui caractérise le capitalisme ? La différence réside dans le fait que l’on n’instrumentalise pas la terre. On ne détient pas le contrôle territorial de quelque chose qui n’est pas directement utilisable. On se base sur un compromis politique, sur un programme d’un autre monde. Comme on ne possède pas de terre, dans la plupart des cas, la traduction immédiate d’une réalité partagée se matérialise par des expérimentations comme les jardins potagers urbains, les squats, les espaces culturels en dehors de la logique du marché, quand bien même ils reposent sur la participation de personnes vulnérables et ne jouissent généralement pas d’une stabilité sur le long terme.
L.M.A. : Pourquoi certains penseurs marxistes ne sont toujours pas convaincus de la pertinence du concept de communalité ? D’ailleurs, John Holloway et d’autres ont exprimés publiquement que ce concept n’est pas combatif.
S.F. : Comme l’ont souligné Luis Tapia et Raúl Zibechi, John Holloway constate un capitalisme totalisant, un capitalisme qui contrôle tous les espaces. Cela étant, il existe beaucoup de lieux où l’on vit sans argent, où l’argent remplit une autre fonction. Par exemple, les zapatistes vendent du café, car ils ne peuvent tout simplement pas produire tout ce dont ils ont besoin. Ils ont choisi un mode de vie qui n’est pas uniquement conditionné par le pouvoir de l’argent. Il est évident qu’aujourd’hui, dans une société capitaliste, le commun ne peut être une chose intrinsèquement pure, parce que c’est un principe qui dépend d’une négociation et d’un arrangement perpétuel avec l’entourage, le voisinage.
Malheureusement, Holloway donne une idée toujours très totalisante du capitalisme, et en ce sens, il se centre seulement sur la lutte. Mais au cours de la lutte, il y a des moments de médiation et de construction. Par exemple, dans les ville-taudis, les barrios, les quartiers déshérités que sont les favelas, qui sont composés essentiellement de personnes issues de la ruralité avec une culture indigène et communautaire, on constate des initiatives de construction de maisons, d’aménagement de l’habitat avec l’entretien des chemins pour faciliter le passage de personnes étrangères à la communauté. J’en ai d’ailleurs visité quelques-unes et elles m’ont impressionnée. Raúl Zibechi mentionne qu’au Pérou, dans un passé pas si lointain, il y avait des milliers de comités (comité de la petite enfance, comité des jardins potagers, …). Tout ce processus de formation du commun au cœur des aires urbaines m’a beaucoup intéressée et je suis loin d’avoir fait le tour de la question. La construction du commun ne s’est pas réalisée seulement dans les aires rurales, mais aussi au niveau des espaces urbains parce que les personnes s’y sont installées.
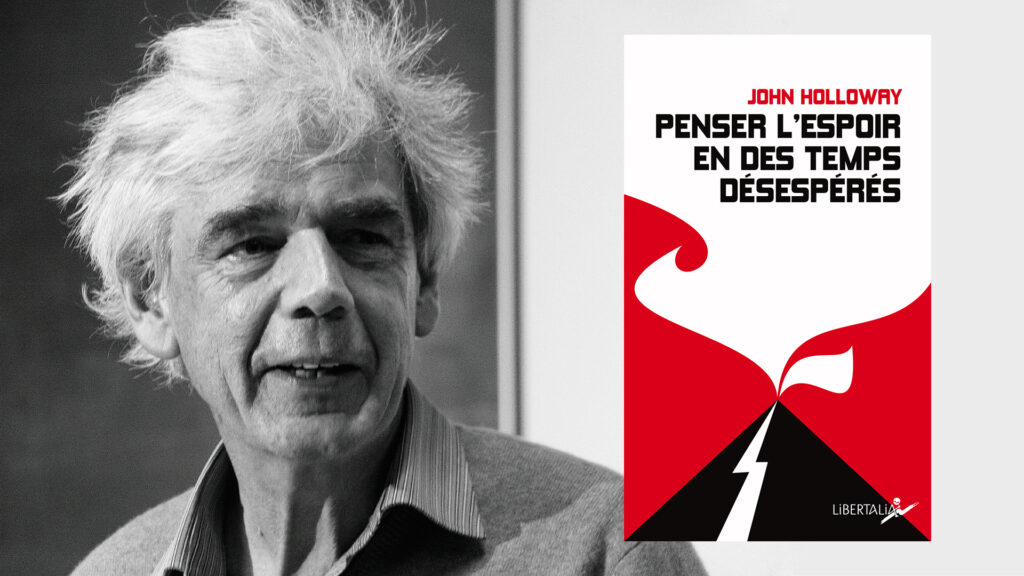
Que signifie la construction du commun ? Quelle signification politique cela peut avoir ? Par exemple, en Argentine la Corriente Villera Independiente des barrios de la ville de Buenos Aires est en train de construire le commun. Evidemment, ces expérimentations sont vulnérables et font l’objet d’une attention particulière de l’État qui les cantonnent à certains, mais elles dénotent la possibilité de construire d’autres formes d’organisation. C’est aussi intéressant de voir comment elles interagissent avec l’État qui monopolise la richesse sociale. Donc, on ne peut pas imaginer que la construction du commun sorte de nulle part. Le commun n’est pas une idée abstraite, un signifiant anhistorique monté en l’air. Il est issu d’un conflit, de négociations qui se perpétuent au fil des générations. Assurément, ces organisations ne permettent pas à l’État d’organiser la reproduction du capital de la façon la plus habituelle possible. La communauté est de prime abord celle qui décide pour le bien-être des enfants, la gestion de l’eau ou pour la construction de logements, etc. Elle a le dernier mot.
L.M.A. : En ce qui concerne l’État, le sociologue Aníbal Quijano soulève le fait qu’un patron de domination/exploitation s’est établi en son sein depuis la conquête de l’Amérique. Ce schéma s’articule autour de la colonialité du pouvoir, qui se reconfigure au cours du XIXe siècle. En d’autres termes, la forme privilégiée prise par l’État latino-américain répond à une logique de domination moderne et d’exploitation capitaliste. En ayant comme horizon la transformation sociale, comment pouvons-nous réfléchir au rôle contemporain de l’État ? Si l’État organique est conçu comme un produit de la modernité/colonialité capitaliste, doit-on le détruire comme le soulignait Marx – ou devons-nous l’occuper à la manière du socialisme du XXIe siècle ?
S.F. Il me semble qu’une partie de la réponse se trouve dans le comportement des mouvements communautaires et de ce nouveau communalisme. Par exemple, les zapatistes rechignent à légitimer les modes de désignation de candidats aux élections ; d’autres mouvements acceptent de négocier, tout en luttant contre la récupération qui pourrait être entreprise insidieusement. Ce sont des phénomènes à la fois complexes et risqués, étant donné que certains membres de ces organisations deviennent candidats, et ce, « à l’insu de leur plein gré ». Je connais bien les cas de la Bolivie, du Brésil ou de l’Équateur et il me parait que la conquête de l’État, même si c’est souvent une décision univoque, n’est pas le meilleur moyen d’agir. L’amour pour l’État du parti communiste italien est un point de divergence que j’assume d’ailleurs sans aucun problème (rire), tant et si bien qu’il synthétise la division de classes. Je crois que ce qui est important, c’est de renforcer les mouvements en partant d’en bas, si l’on part du principe que l’État a le monopole de la violence légitime en mobilisant l’armée et la police.
Dans ce cadre-là, l’État ne te donne rien et participe à armer la violence légitime. L’État doit être réduit à sa forme la plus minimaliste possible pour faciliter l’émergence d’une société autogérée. En ce sens, je pense qu’il est important d’opérer la distinction entre ce qui relève du public et du commun. Le public, c’est ce qui est contrôlé par l’État et qui peut être privatisé à n’importe quel moment, comme on peut le constater actuellement. Des pans entiers du secteur public sont privatisés et à ce titre, on ne peut pas considérer l’État comme un allié ou un ami. La relation que l’on entretient avec l’État est empreinte d’antagonismes. Le cas de Lula Da Silva et du Parti des travailleurs au Brésil est symptomatique de la défense du néolibéralisme consécutive à l’accès à des postes d’autorité et à une capacité de décision pour ensuite consolider des politiques extractives. La concentration des terres aux mains de l’agro-business s’est ainsi accrue alors que la population espérait une réforme agraire. Je me rappelle par exemple le processus de destitution de Dilma Roussef (Impeachment) en 2016, alors que je participais à une réunion organisée par les femmes prolétaires d’organisations populaires à Sao Paulo (Mulheres perifericas, Mães de Maio et des travailleuses du sexe) : les militantes du mouvement Mães de Maio arguaient la chose suivante : « nous n’allons pas pleurer pour Dilma Roussef, parce que pour nous, dans les favelas, la dictature n’a jamais cessé ».
On omet souvent de préciser qu’au cours du mandat du PT, les mesures répressives contre les personnes les plus vulnérables au Brésil se sont accentuées. La politique que les potentats du PT ont entreprise est une politique de répression contre les indigènes, pire encore que celle pratiquée par la droite. Le simple fait qu’ils se considèrent être des représentants légitimes de la modernisation est suffisant pour aller contre les intérêts des populations indigènes. Ils considèrent que privatiser des terres par la voie légale et ainsi mettre en œuvre une politique extractive pour récupérer des ressources, c’est une posture garante du bien-être, assurant par la même occasion une politique d’assistanat. Cela ne change pas vraiment les rapports de force et n’a pour ainsi dire que très peu d’incidence sur la structure capitaliste de la société. L’assistanat accompagne ainsi une dépossession sous couvert de bienveillance. Alors, que ce soit sous l’égide d’Evo Morales, Lula Da Silva, Rafael Correa, l’extractivisme a toujours eu une place de choix. Et maintenant, Lula est devenu un martyr. Je vous conseille, à ce sujet, de lire les travaux de Raúl Zibechi afin de saisir la responsabilité paradoxale de Lula Da Silva dans la promotion de l’impérialisme brésilien1.
L.M.A. : Effectivement, Zibechi démontre que nombre de mégaprojets du PT remontent à la dictature militaire (1964-1985). Ils ne sont aucunement novateurs et encore moins émancipateurs…
S.F. Oui, on ne peut pas le nier et encore moins l’oublier. Aujourd’hui, dès qu’un compagnon critique Lula je me rends compte de cette croyance aveugle qui s’inscrit bel et bien dans un déterminisme de l’histoire. J’ai d’ailleurs du mal à accepter le dialogue avec cette vision du communisme traditionnel qui reste singulièrement statique…
L.M.A. : Comment interprétez-vous la vague de féminicides qui se repend sur toute l’Amérique latine ? Ma question recoupe deux points névralgiques : comment pouvons-nous mettre en relation cette vague avec la logique néolibérale qui rend la marchandisation des corps inévitables ; et dans un second temps, quelles stratégies sont mises en place par les femmes, aussi bien au niveau individuel que sur le plan communautaire, dans cette lutte pour la survie ?
S.F. : Je considère qu’il y a plusieurs réponses. Cependant, toutes découlent de l’accumulation capitaliste. Rita Segato propose l’idée d’une pédagogie de la cruauté pour comprendre la nouvelle forme de violence qui s’exprime fréquemment et avec brutalité. Segato souligne la collusion entre cette violence et les formes illégales que revêtent l’accumulation capitaliste à travers le narcotrafic, le trafic d’armes et la prostitution. En conséquence, cela entraîne une militarisation de la vie quotidienne. Les compagnies pétrolières comptent sur leurs propres milices, quand ce n’est pas l’armée.

Cela dénote une privatisation même des guerres et des conflits liés aux différents types d’extraction. D’un autre côté, l’agentivité des femmes est évidente, puisqu’elles se trouvent à l’avant-garde de la défense du territoire, de la terre, en opposition aux projets miniers et contre les compagnies pétrolières. Il me semble que ces phénomènes expliquent les vagues de féminicides et la pédagogie de la cruauté qui conduit à la mort, mais aussi à des actes de torture. Il y a une visibilité du corps torturé dans l’espace public. De plus, d’autres camarades ont démontré le fait que les femmes doivent travailler dans des espaces toujours plus dangereux. Le cas des femmes migrantes est symptomatique.
Elles doivent se procurer des contraceptifs pour prévenir les conséquences du risque d’être violées au cours de leurs déplacements. Mon ami Jules Falquet a rédigé un article très intéressant au cours duquel il aborde la question de la nouvelle division du travail sexuel et de la militarisation de la vie quotidienne2. D’un côté, cela induit les conditions de nouveaux modèles de masculinité toujours plus agressifs, machistes et violents. Cela complique la recherche d’autonomie pour les femmes avec pour conséquence une atteinte directe à la masculinité, disons, « populaire ». La vague de féminicides est donc multifactorielle et tous ces facteurs nous aident à en comprendre les tenants et les aboutissants. Évidemment, lorsqu’on parle de violence, on ne doit pas penser seulement à la violence de la loi qui a comme corollaire la violence économique, mais aussi et surtout à la violence purement physique et verbale.
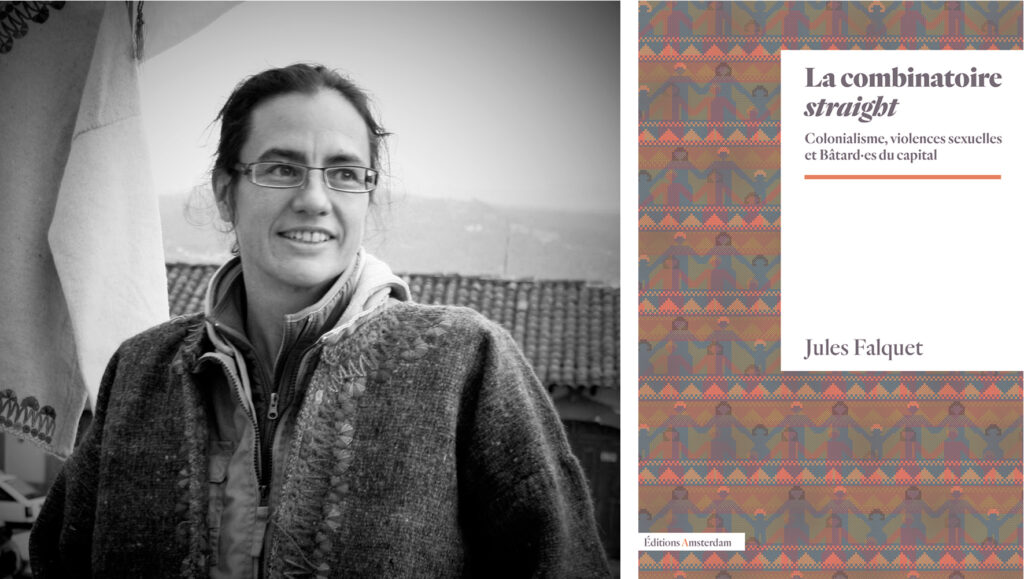
L.M.A. : Selon vous, quel est l’apport de ces mouvements sociaux et des luttes populaires qui se tiennent dans toute l’Amérique latine ? De quelle manière ils enrichissent la notion de justice sociale ?
S.F. Je pense que les camarades latino-américains pourraient répondre mieux que moi à cette question, puisque je n’ai pas la prétention de me substituer à leurs vies et encore moins de vous faire part de leurs ressentis par le biais de mes connaissances. Je peux seulement revenir sur ce que j’ai appris d’elles et je pense que le mieux est de parler avec des femmes comme Rita Segato, Gladys Tzul Tzul ou Ivonne Yañez (militante d’action écologique de Quito), pour n’en mentionner que quelques-unes. Je trouve que la notion de justice sociale prend tout son sens au contact des régimes communautaires. La camarade Dawn Paley, journaliste canadienne résidente au Mexique, a écrit un livre sur la guerre contre la drogue dans lequel elle soulève le fait que c’est un prétexte pour lutter contre les indigènes, les paysans et surtout les pauvres.
Si l’on suit la perspective de l’État, d’après Dawn Paley, celui qui défend le territoire devient nécessairement un insurgé ou un terroriste3. Actuellement, les gouvernements sont en train de tuer tous ceux qui défendent leurs territoires. Pour autant, la notion de justice sociale est une notion qui doit en englober d’autres telles que la souveraineté alimentaire, la défense du territoire, l’autonomie ou l’autogouvernement. Un ensemble de notions qui vont au-delà de la justice libérale bourgeoise. Le territoire n’est ni plus ni moins qu’une base matérielle constitutive du sujet collectif.
Pour prolonger
- Le capitalisme patriarcal ( Dans le texte avec Silvia Federici, mai 2019)
- Ce cauchemar qui n’en finit pas (Dans le texte avec Christian Laval, juin 2016)
- L’expérience zapatiste (Aux sources avec Jérôme Baschet, mars 2017)
- Raúl ZIBECHI, Brasil Potencia: entre la integración regional y un nuevo imperialismo, Zambra, Málaga, 2012. ↩︎
- Jules FALQUET, « Division sexuelle du travail révolutionnaire : réflexions à partir de l’expérience salvadorienne (1970-1994) », Cahiers des Amériques latines, 2002, pp. 109-128. ↩︎
- Dawn PALEY, Drug War Capitalism, California, AK Press, 2014. ↩︎


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.