Judith Bernard : La naissance de Potere al popolo, c’est d’abord un livre, publié en 2014, et puis à partir de 2015, c’est l’occupation de cette prison psychiatrique où nous sommes. Est ce que tu peux nous dire quel rôle joue ce lieu dans votre pratique et dans votre théorie politique ?
Salvatore Prinzi : Pour répondre à cette question, il faut remonter à la crise de 2008 : on a vu qu’une grande crise s’annonçait et que personne, du point de vue de la représentation politique, n’était capable de répondre aux besoins des classes populaires. Ça coïncide avec les élections de mai 2008, que Berlusconi gagne, en même temps que s’effondre ce qui restait du communisme. Nous, nous venons plutôt d’une idée du communisme révolutionnaire, des mouvements sociaux italiens. L’idée, c’était que face à ce gouvernement de droite et à cette crise économique, il y aurait la possibilité de créer de grandes manifestations, et au sein de ces grandes manifestations, de faire naître quelque chose de nouveau.
C’était un peu ingénu, mais grosso modo, l’idée, c’était ça. Donc on passe toute la période de 2008 à 2011 à s’organiser, à créer différents mouvements ; il y un mouvement étudiant qui est très important, et donc on fait beaucoup, beaucoup de mobilisations – un peu comme en France, et même plus qu’en France dans la même période. Sauf que ce qui nous manque, c’est une capacité de représentation politique, et la possibilité de transformer tout ça dans une organisation. Il y a une tentative de récupération politique du mouvement par la gauche réformiste, pour ramener sa composante la moins radicale dans le centre gauche. Cette tentative est contestée au sein du mouvement, ce qui génère de grands conflits internes, entre la partie du mouvement la plus modérée, autrefois dite « désobéissante », qui pensait qu’il fallait « contaminer » le centre gauche, et la composante plus antagoniste, où nous étions, nous, avec les autonomes et d’autres groupes…
J.B : Tu dis « nous » : à ce moment-là, vous vous situiez comme une organisation constituée ?
S.P : Non, pas du tout. On était issus de collectifs de base qui collaboraient beaucoup entre eux ; nous, on avait un autre centre social à l’époque, dans la banlieue de Naples, on avait créé un collectif à l’université en 2008 – qui existe toujours et qui a d’ailleurs été récemment infiltré par la police. Il y avait aussi des autonomes qui venaient du negrisme, mais plutôt du côté des expériences radicales des années 70… Il y avait toute une galaxie en fait. Et nous, on tentait toujours de fédérer cette galaxie pour empêcher que le mouvement soit récupéré par le centre gauche. Il y avait des conflits, des débats théoriques : la composante la plus à droite du mouvement postulait par exemple que les « travailleurs » n’existaient plus, que donc il fallait créer des mouvements d’opinion, ils parlaient beaucoup alors du « capitalisme cognitif »…
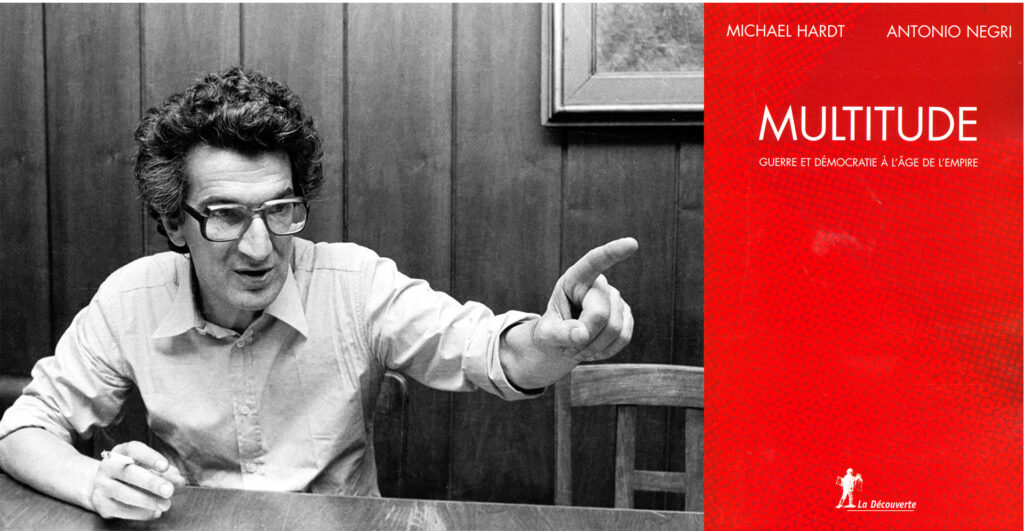
Il a fallu batailler, au côté des syndicats de base, et cette lutte a été assez forte pour empêcher la récupération du mouvement. Il y a eu deux manifestations qui ont signé l’impossibilité pour le centre gauche de récupérer ce mouvement : c’est le 14 décembre 2010, manifestation de l’université à Rome, où les réformistes ont tenté de mettre un terme à la manifestation avec des prises de parole de représentants d’organisations liées au centre gauche, sauf que les étudiants ont débordé la place, et marché vers le parlement pour chasser Berlusconi, ce qui a donné lieu à des conflits énormes. Et un deuxième épisode, à Rome toujours, le 15 octobre 2011, où a lieu une bagarre énorme avec la police lors d’une véritable journée de révolte. Le centre gauche a fini par conclure que ces gens là étaient vraiment…
J.B : …Irrécupérables ?
S.P : Irrécupérables, oui. Mais j’ajouterai que toute notre histoire, c’est aussi l’histoire d’une auto-critique dans le sens où nous on était assez forts, en tant que mouvement social, pour empêcher la récupération par une gauche modérée historique, mais en même temps, on n’était pas capables de produire une subjectivation politique : on était dans la phase de destruction.
Et par ailleurs, il y avait le Mouvement Cinq étoiles qui avait commencé à grandir, et qui pouvait bénéficier du capital médiatique de Beppe Grillo, du capital économique de Casalegio1 et d’un discours très « antipolitique », qui disait que « le problème, c’est la politique, les politiciens… », idée assez présente dans le sens commun italien depuis toujours. C’est Cinq étoiles, au final, qui a profité de la crise. À un moment donné, les gens se sont dit : « Avec ces manifs, on n’arrive à rien. Il faut tenter la voie électorale avec Cinq étoiles parce que s’ils prennent le pouvoir, ils vont changer le système ». Donc en février 2013, aux élections italiennes, le Mouvement Cinq étoiles remporte 25 % des suffrages, et ça paralyse tout jusqu’en 2018 parce que les gens se disent qu’il faut attendre que ces gens-là arrivent au gouvernement.
Or, comme vous le savez, quand ils arrivent au gouvernement, ils trahissent tout ce qu’ils avaient promis – ce qui génère une deuxième déception. Il y a beaucoup de gens des classes populaires qui ont eu une première déception dans les années 90 avec le centre gauche, les anciens communistes qui ont rallié la doctrine libérale, et une deuxième déception, beaucoup plus courte et rapide, avec le mouvement Cinq étoiles. Le jeune parti « antipolitique » qui devait changer tout, et qui est finalement devenu comme les autres. C’est ça qui explique en partie l’abstention énorme qu’on a aujourd’hui en Italie.
De notre côté, on s’est mobilisé, et à un moment donné, on s’est trouvé avec cette situation politique bloquée. Il n’y avait plus de grands mouvements de masse : les mouvements rentraient dans des petites niches un peu identitaires, avec des petits soubresauts, de temps en temps, mais qui généraient toujours les mêmes débats – « Est-ce que les travailleurs existent ou pas ? ». C’est le moment où on a écrit ce livre que tu mentionnais2, qui consistait dans une enquête sur la classe travailleuse en Italie et les classes populaires en général. On y fait une analyse du système italien : une analyse quantitative d’un point de vue statistique et une analyse qualitative avec des entretiens, articulés à la question des luttes. C’est un petit livre de 230 pages qui démontre que la classe ouvrière, dans un sens certes beaucoup plus ouvert que précédemment, existe toujours, qu’elle mène même des luttes, mais des luttes de secteur, ou très localisées. Donc il faut commencer à fédérer tout ça. Ce moment de reflux politique, c’est aussi un moment où les gens se posent des questions et nous sollicitent pour venir parler : on va chez les gens de « la corrente dei disobbedienti » (le courant des désobéissants), chez les autonomes, les associations de base, les syndicats un peu partout…

JB : Ils vous invitent à venir discuter sur la base de ce livre ?
S.P. Oui, on discute du livre : on a fait au total 83 présentations. J’ai fait 50 de ces 83 présentations et donc ça nous a permis de construire un premier réseau. Et pendant ce temps, au cours de 2014, il y a la première percée de Podemos, il y a évidemment Syriza qui monte, qui finalement gagne en janvier 2015 : pour nous à ce moment-là, toujours de manière un peu ingénue, la voie électorale devient une évidence. Mais pour les autres, ce n’est pas le cas : il y avait une résistance très identitaire par rapport aux élections de la part des mouvements sociaux du mouvement révolutionnaire. Et en plus, l’espace était déjà occupé par le mouvement Cinq étoiles. Donc nous à la fin de 2014, on est allé presque partout, on connaît beaucoup de gens, on est respectés parce qu’on a une « street credibility » pour toutes les luttes qu’on a faites, et en même temps un niveau théorique suffisant. Il nous semble alors qu’il faut créer une organisation qui joue un peu avec le populisme de gauche, mais qui reste très liée à l’histoire de la gauche, aux mouvements sociaux, et on a fait le calcul que le mouvement Cinq étoiles allait rater son opportunité parce que c’était la base même de son projet, d’un point de vue structurel, qui ne pouvait pas fonctionner.
On fait cette proposition à des gens qui, après, nous ont donné raison et sont entrés dans Potere al popolo, mais qui à ce moment-là ne faisaient pas confiance au principe des élections. Et tout ça, c’était janvier 2015, tout de suite après la victoire de Syriza : nous, on a dit : « Il se passe quelque chose au niveau européen. Il faut profiter de ça. » Beaucoup de gens nous donnaient raison, mais on n’a pas réussi à les convaincre de nous rejoindre. Alors on s’est dit qu’il fallait montrer que cette nouvelle approche, qui continue une histoire mais qui essaie d’être un peu plus dynamique, un peu plus « communicative », consistant à mettre au centre les besoins des gens, reposant sur l’écoute et l’aide directe, était la nouvelle forme de construction du parti. On s’est dit qu’il fallait l’expérimenter, parce qu’on ne peut pas convaincre les gens en parlant : il faut démontrer par la pratique. Donc on occupe l’ex OPG3 avec, dès l’origine, au cœur du projet, un but politique de construction de l’organisation. On y entre le 2 mars 2015, avec déjà pas mal d’expérience d’occupations à notre actif – moi j’ai commencé à treize ans ! – et on ne voulait surtout pas faire une occupation à la mode « politique », pour les jeunes, pour les antagonistes, pour les gens habillés en noir avec un imaginaire Che Guevara… On voulait faire quelque chose de populaire : « populaire », dans une ville comme Naples, ça signifie par exemple utiliser des mots en napolitain, parler d’une manière très compréhensible, donc pas trop idéologique, partir des besoins concrets des gens et surtout organiser les gens.
L’idée, c’était d’occuper un endroit assez grand (ici c’est 9000 mètres carrés, c’est énorme !) pour faire la démonstration que si l’État, surtout au Sud, n’est pas capable de répondre aux besoins des gens, il ne faut pas attendre d’être au pouvoir : il ne faut pas déléguer, parce que de toute façon la classe politique ne va pas résoudre les problèmes. Il faut être concret et commencer à organiser les gens. De cette manière, on pouvait aussi démontrer que le Mouvement Cinq étoiles ne servait à rien : c’était des gens dans les institutions, qui criaient beaucoup, mais qui n’étaient pas capables de résoudre les problèmes des gens.

L’idée pour nous était de commencer avec cette activité qu’on appelle le « mutualisme conflictuel ». C’est une idée qui comprend plusieurs niveaux : premier niveau, dans un moment où il n’y avait une grande politisation de la société : partir du concret, du quartier, par exemple d’une lutte sur la santé publique, qui permet de motiver les gens. Deuxièmement : gagner des petites choses. Il ne fallait surtout pas continuer avec ce discours de défaite de la gauche : « On a toujours perdu, on n’a pas réussi », d’autant plus déprimant qu’il n’y a jamais eu d’autocritique radicale pour se mettre dans la position de gagner.
Nous, on a fait notre autocritique, maintenant, c’est le moment de commencer à gagner. De toutes petites choses : par exemple les escaliers que vous voyez dehors, c’était fermé parce qu’ils avaient abandonné cet endroit et cessé d’entretenir l’escalier. Les arbres et la nature avaient envahi l’endroit, alors que l’escalier est très utile, il permet de gagner 7 minutes à pied pour rejoindre le centre du quartier, c’est essentiel, surtout pour les femmes d’un certain âge, qui portent les courses avec des sacs très lourds. Pour récupérer la rue, il ne fallait pas demander aux services publics de s’activer : de toute façon ça ne servait à rien. Nous, on s’est mis avec les gens du quartier, on a récupéré la rue et les gens étaient très contents : ça, c’est une petite victoire. Donc on commence à faire des petites luttes qui donnent l’impression qu’on peut gagner, on peut changer les choses, et ça va peu à peu motiver les gens. Pour nous, c’est aussi une manière de faire une enquête sociale concrète et de connaître mieux notre sujet. Et troisième niveau, c’était justement de développer la capacité des gens à résoudre eux-mêmes les problèmes.
Dans notre analyse des problèmes du socialisme réel, on identifiait qu’il activait un mécanisme qui descendait du haut vers le bas : il n’y avait pas de mécanisme de retour, pas de feed back, mais surtout il n’y avait pas l’activation des gens. C’est la chose bizarre du communisme historique : soit du fait de la peur, soit du fait que ce soit difficile, soit du fait de la pression des impérialismes de l’extérieur, la direction du parti a essayé de décourager la participation des gens, sauf exceptionnellement pour les activer dans des journées très précises…
J.B : Pour aller voter ?
S.P : Pour aller voter, mais aussi surtout, si je pense à l’Union soviétique, pour les journées « de la défense », « de la mémoire »… Mais en général, c’était des sociétés très peu politisées, ce qui est un paradoxe ! Notre modèle à nous, c’est assez gramscien : c’est un socialisme qui naît du bas, qui mène une activité pédagogique réciproque entre la direction politique qui doit apprendre du « bas » et le « bas » qui doit apprendre du parti les outils de la politique organisée.
Pour vous donner un exemple concret, on a mené la lutte sur l’escalier, mais on a fait aussi une lutte pour mettre un feu tricolore sur la rue parce qu’il y avait eu plusieurs accidents, des gens renversés par les voitures qui passent, et une femme de 63 ans qui en est morte. C’était une femme de l’église, qui organisait le catéchisme, très connue dans le quartier. Donc nous, on est allés parler avec les prêtres : on se connaissait, ils savaient qu’on faisait de « bonnes choses », qu’il n’y avait pas de drogue – toutes ces choses que la rhétorique de droite pourrait associer à notre centre, qui ne fonctionnent pas pour nous parce que nous, on fait du bricolage, on fait jouer gamins, on fait des présentations de livres… Avec cette bonne renommée, on va dire à ce prêtre qu’on va se mobiliser pour mettre un feu tricolore sur la rue, et le prêtre nous invite à venir parler à l’église. On y va très ouvertement, avec un tract, on fait une collecte de signatures – des choses que normalement la gauche a longtemps faites, qui ont peut-être été un peu oubliées : c’est le travail sur le terrain. Mais surtout l’idée, c’est que ce n’est pas nous qui allons faire la rencontre avec les interlocuteurs de la mairie ; bien sûr, on fait profiter de notre expérience, mais on amène tous les gens du quartier. Et quand la mairie ne veut pas nous recevoir, on se sert des tactiques des mouvements antagonistes, on entre dans les bureaux et on les occupe. Donc il y a une communication entre la force populaire et les techniques qu’on a apprises dans les mouvements sociaux : il y a cette jonction entre des tactiques d’agitation très radicales et une justification liée aux classes populaires, ce qui marche très bien. On a aussi fait nous-mêmes un feu…
J.B : Un feu tricolore ?
S.P : Oui, un faux feu, qu’on a fabriqué ; c’était un mode d’action un peu ironique qui affirmait « vous n’y arrivez pas, nous on le construit » ! Ce sont les gamins du quartier qui l’ont construit, et finalement on a gagné la bataille, on a obtenu un vrai feu, ce qui a fait que la mortalité sur cette rue a beaucoup diminué. Ainsi les gens ont pu constater que nous, on a fait ce que tous les conseillers de la municipalité n’ont pas su faire pendant longtemps, arguant toujours qu’il n’y avait pas l’argent pour le faire.
Bref, tous ces phénomènes d’expérimentation et ces luttes font qu’au niveau national, on commence à parler de l’ex OPG. Les gens sont très impressionnés par le fait que nous, qui étions vus comme les communistes durs, purs, marxistes, léninistes, maoïstes, on avait une capacité, à nouveau, à parler à des gens d’une manière beaucoup plus large, mais sans renier notre radicalité. Normalement, il y a toujours l’équation : « Soit tu dis les choses nettes et claires et tu parles avec très peu des gens, soit tu dis des choses un peu plus modérées, et tu peux parler avec des couches plus larges ». Nous on parlait simple – c’était un peu le populisme de gauche de cette période – mais on essayait de mener plus concrètement la lutte et de faire une expérimentation sur un territoire.
J.B : Mais du coup, du point de vue de la population locale, ce centre a pu être vécu comme un « prestataire de services » : ça procure des services, des aides, ça agit sur le territoire localement pour mettre un feu tricolore, etc. Mais comment se fait l’articulation avec le projet à visée révolutionnaire, la stratégie politique ? Comment on fait rentrer la population locale dans une vision plus large ?
S.P : Tout à fait…
J.B : Et aussi, comment vous vous défendez d’être perçu comme un organisme de charité ? Est-ce qu’il n’y a pas un peu ce risque-là, d’être vu comme un pourvoyeur d’actes de charité ?
S.P : C’est une très bonne question, et on n’a pas trouvé la solution magique. C’était une critique qu’on nous faisait souvent, émanant des autres groupuscules d’extrême gauche qui nous disaient : « Vous avez bien changé, maintenant vous faites de la charité rouge ». Et nous, on a bien montré que, historiquement, c’était ce que faisait le premier Parti socialiste en Italie quand il était révolutionnaire, que c’était ce que faisaient les communistes dans les Maisons du peuple… Nous on reprend tout l’imaginaire des Maisons du peuple qui s’étaient développées en Italie, et qui ont été abandonnées, et puis on renvoie surtout au Black Panther Party : ça c’est une référence majeure. C’est pour ça que le parti s’appelle Potere al popolo, parce que « Power to the People », c’était le slogan du Black Panther Party. Donc c’est une forme de maoïsme, mais moins idéologique, comme dans le BPP où ils avaient mis en œuvre le programme des petit-déjeûners pour les gamins du quartier ; notre idée c’était vraiment d’organiser les gens pour répondre aux problèmes, et montrer l’incurie de l’Etat.

Le problème c’est qu’il y a des gens qui viennent juste pour profiter d’un service gratuit : c’est un risque, il faut le reconnaître. Tous les gens qui viennent faire de la gym – parce qu’on a de la gym, on a du théâtre, on a des choses plus détachées de la politique qui sont proposées ici – tous ces gens ne restent pas. Ce qu’on a remarqué, c’est que la manière de faire rester les gens, c’est de faire une activité qui débouche sur un aspect politique. Par exemple, on commence le périscolaire pour les enfants du quartier, parce qu’il y a un taux d’abandon scolaire énorme à Naples, surtout dans les quartiers populaires comme ici. Donc nous, on essaie de rattraper ces jeunes en leur proposant des petits cours après l’école, et ça fonctionne très bien. On pourrait s’arrêter là, comme beaucoup d’associations, catholiques ou autres, qui font ça. Mais nous, on dit : « on veut connaître votre contexte familial, on veut parler avec vos mères ». Donc on organise des rencontres avec les mères, pour les interroger sur les problèmes qu’elles rencontrent. L’enquête permet de comprendre que ces familles aux très faibles revenus ont le droit d’avoir les manuels scolaires gratuitement, donc ne les achètent pas, mais que les livres gratuits, du fait de retards et de négligences bureaucratiques, n’arrivent pas en septembre à l’école, mais en janvier de l’année suivante ! Les enfants n’ont donc pas de manuels pendant 3 à 4 mois, ils perçoivent une différence avec les autres qui les ont, ils utilisent aussi cette situation comme excuse pour ne pas travailler, et tout ça, ça contribue à déterminer les difficultés scolaires des enfants issus des classes populaires.
Donc là, on répond aux mères que c’est un droit, et qu’elles ont le droit de le faire respecter. Ces gens nous répondaient qu’ils ne savaient pas par où commencer, qu’ils ne savaient même pas à qui il faut demander ça. Et ça, nous on le savait, parce qu’on peut lire les règlements. Donc on a regroupé les mères, on est allés voir l’autorité scolaire napolitaine pour avoir les livres, et ça a fonctionné ! Parce que ces autorités ont peur que soit diffusée publiquement une mauvaise image de leur travail : nous on a la maîtrise des réseaux sociaux, on connaît les journalistes, parce qu’ils ont couvert les manifestations et qu’on a gardé les contacts… Et magiquement, les livres sont arrivés. Là, les gens ont dit : « ça sert de s’organiser sous la forme d’un collectif de base ».
Donc quand on a la force de mener ces petites batailles, les gens cessent de percevoir qu’ils sont dans une association qui procure « juste » de bons services. Quand tu laisses la chose un peu plus libre, par exemple pour la gym, eh bien les gens viennent juste faire de la gym gratuitement. Ce qu’on a mis en place pour limiter ce problème, comme aussi les problèmes liés à la gestion du bâtiment comme…
J.B : Comme s’il s’agissait juste d’une gestion copropriété…
S.P : Oui, voilà. Nous on ouvre les activités sociales quand on peut y associer des cadres politiques. Si on commence la gym, c’est parce qu’on a un cadre politique qui peut suivre l’activité. Si on ouvre l’activité théâtrale, c’est parce qu’on a des cadres politiques disponibles…
J.B : Mais comment ça ? Un cadre politique pour la gym par exemple, ce serait quoi ?
S.P : Par exemple, veiller au cadre, c’est organiser l’activité en étant sûrs que les gens s’occupent aussi de la propreté du lieu. Et donc, il y a des moments d’activités pour nettoyer l’espace…

J.B : Il y a une responsabilisation des participants…
S.P : Voilà, exactement : responsabilisation. Ça veut dire aussi, par exemple, organiser d’aller boire un verre avec les gens qui participent à l’espace pour se connaître mieux, et pour empêcher que ça soit juste un service. On dit aux gens qui viennent : « vous êtes là, vous n’allez pas payer, mais évidement vous n’êtes pas des clients. Si quelque chose ne marche pas ici, c’est aussi votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous plaindre, par exemple, parce qu’il y a un miroir qui est cassé. Il faut s’organiser pour changer le miroir, ou l’ampoule qui ne marche plus. » Il y a donc des moments de socialisation en dehors de la gym pour ceux qui viennent faire de la gym.
L’idée théorique à la base, c’est que le capitalisme aujourd’hui comprend trois niveaux – on pourrait dire beaucoup plus, mais disons basiquement : trois niveaux de contradiction. Le premier, c’est le niveau classique, économique, au sens où il y a des gens qui possèdent les moyens des production et des gens qui doivent vendre leur force de travail. Le deuxième est le niveau politique : il y a des gens qui ont le pouvoir médiatique et politique et qui peuvent imposer leur volonté à la majorité qui n’a pas les mêmes moyens et qui est exclue des décisions politiques. Mais il y a aussi un troisième niveau de contradiction, lié à la fragmentation que le capitalisme opère parmi les gens, à l’intérieur de la classe et même à l’intérieur de l’individu lui-même.
On s’est demandé : pourquoi ce qui fonctionnait dans le passé ne fonctionne plus aujourd’hui ? En Italie, il y avait des mouvements et des partis très forts, et même des syndicats très forts, parce qu’il y avait des terrains sociaux qui existaient et qui constituaient des préalables à l’action politique. Evidemment, l’activité politique a toujours été très dure, mais par exemple l’usine produisait une communauté de gens – après il fallait s’y disputer entre communistes, réformistes, conservateurs pour la direction du mouvement ouvrier, il y avait des conflits, mais il y avait un préalable. Autre exemple, les bars : en Italie, les bars ont été longtemps des lieux de socialisation, c’étaient des préalables. Les gens passaient des journées dans les bars des quartiers. L’église, évidemment, c’était un terrain, même pour les communistes, qui allaient faire du tractage sur le parvis de l’église. Il y avait donc des préalables. L’école, l’université sont encore ce type de préalable, il ne faut pas céder à la tentation de dire qu’il n’y a plus rien – on le voit d’autant mieux que le pouvoir essaie d’entraver ces espaces…

J.B : C’est un symptôme…
S.P : Oui : Trump, aux Etats-Unis, s’en prend même aux universités les plus néolibérales ! Et ici, en Italie, ce n’est pas un hasard si l’infiltration policière a commencé à l’université. Donc évidemment, il ne faut pas dire que tout ça est fini : il y a des continuités. Mais il y a une fragmentation telle dans certains secteurs, en particulier le travail, que les gens en viennent à penser que sur le terrain du travail, ils ne peuvent rien changer et en plus ils considèrent que ce n’est pas leur vraie vie, ce n’est pas quelque chose qui les définit. La chose qui les définit, c’est tout ce qui se passe à côté et là, peut-être, quelque chose peut être changé, au niveau de la qualité de la vie dans le monde. Nous on passe par cette perception, qui existe parmi les classes populaires ; si on la laisse comme ça, c’est un sentiment conservateur : « Je peux juste changer ma vie privée ». Je pense que ça détermine aussi beaucoup l’approche des questions du genre et de la sexualité. « J’ai perdu la possibilité de changer le monde »…

J.B : … »Donc je m’occupe de changer ma personne »
S.P : « Je peux me construire. Ma créativité, mon espace de liberté, ça peut être seulement à l’échelle de mon individualité ». Évidemment, il y a des raisons justes et concrètes à ces désirs, mais c’est aussi trompeur de penser que tu ne peux rien changer, et que la seule possibilité de changer la vie c’est la possibilité d’acheter une voiture, c’est juste de la consommation privée. Nous on essaie de répondre à cette aspiration en disant qu’il faut intervenir là, mais d’une manière collective. Donc par exemple, l’escalier, c’est quoi ? Ce n’est pas la classique bataille sur le travail, mais c’est un problème de qualité de la vie et donc on le traite collectivement, et ça fonctionne. Ça permet de générer un phénomène de participation politique qui va au delà du simple service. La gym aussi c’est pour améliorer la qualité de la vie ; ça coûte trop cher, donc on s’organise, on résout le problème collectivement et chacun prend sa part de responsabilité. On esquisse ainsi le passage du social au politique.
On ne peut pas prétendre diriger un terrain social qui n’existe plus. Notre activité politique, dans ce moment historique, consiste à reconstruire le terrain social, mais à le reconstruire d’emblée d’une manière politiquement orientée. C’est exactement ce qui se passe à droite, dans la manière dont les nouveaux fascismes, par exemple le trumpisme, reconstruisent le terrain social. C’est impossible pour nous d’entrer : le terrain est construit de telle manière qu’on en est déjà exclu. Et ça produit un résultat politique. Le simple fait de le construire, c’est déjà un résultat politique que tu peux cultiver. Pour nous, c’est très difficile d’entrer, et de faire la même chose que Trump, d’être par exemple sur certains réseaux, sur certaines questions, de tenter d’y être hégémoniques, parce que c’est déjà orienté, dans la manière même dont la relation est construite.
Ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux, c’est un terrain qu’on ne peut pas investir. Nous, on l’a utilisé pour créer un cercle lié à nos activités en santé ambulatoire, pour le petit hôpital qu’on a ici, qui fournit des services médicaux. Là, par exemple, les réseaux sociaux étaient nécessaires : on avait des médecins qui travaillaient bénévolement, on faisait des actions dans les quartiers, et en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux on a pu communiquer sur notre activité et faire savoir que ce qui manquait dans notre secteur c’était la cardiologie : « Est ce que par hasard, il y a des cardiologues qui veulent venir chez nous ? » Évidemment, ta visibilité sur les médias, ça compte pour que les gens viennent. Et on a pu ouvrir un service de cardiologie, et le faire savoir : les gens se sont dit : « Mais ça fonctionne! ». Ensuite on a fait un crowdfunding, pour ouvrir un service de gynécologie, on avait besoin d’un appareil à échographie : on a récolté 20 000€, et on l’a acheté. À chaque fois on communique sur les réseaux sociaux sur ce qu’on fait…
(Fin de la première partie ; à suivre…)
- Gianroberto Casaleggio était le responsable éditorial du blog de Beppe Grillo, et le cofondateur du Mouvement 5 étoiles, qualifié par certains de « gourou » en raison de son rôle d’idéologue du Mouvement ↩︎
- Dove sono i nostri. Lavoro, classi e movimenti nell’Italia della crisi , 2014 [Où en sommes-nous? Travail, classes et mouvements dans l’Italie en crise] par le collectif politique Clash City Workers. ↩︎
- L’ancien OPG « Je so’ pazzo » est un centre social autogéré situé dans le quartier Materdei à Naples. Le bâtiment qui l’abrite est un ancien couvent du XVIIe siècle ; entre 1925 et 1975, il est converti en hôpital psychiatrique médico-légal, des modifications architecturales adaptent la structure aux fonctions de détention et de contrôle propres à un pénitencier panoptique. Déclaré inadapté en 2000, l’OPG est resté officiellement en activité jusqu’en 2008, année de sa fermeture définitive. Les patients ont été transférés dans une aile extérieure de la prison de Secondigliano, tandis que le bâtiment Materdei a été abandonné et laissé à l’abandon. Le 2 mars 2015, le bâtiment est occupé par un groupe hétérogène composé d’étudiants et de militants de la CAU Naples, dont les fondateurs de Potere al popolo ↩︎


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.