Le 3 janvier, le monde découvre sidéré l’attaque menée par les Etats-Unis sur le sol vénézuélien et l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores. Les chaines d’info basculent alors en édition spéciale, diffusent en boucle les rares images des bombardements à Caracas… et bavardent pour ne rien dire.
Passé le choc des premières heures, les rédactions retrouvent leurs esprits et se mettent immédiatement en ordre de bataille. Désormais, une obsession les anime, une question les mobilise : Maduro était-il un dictateur ? De CNews à Quotidien, de BFM à France Info, la même partition se joue et se répète à la perfection. La focalisation abusive sur la nature du régime vénézuélien frise le burlesque.
Un journalisme policier
Convoqués à la télévision et à la radio, les Insoumis subissent des entretiens dignes d’un véritable interrogatoire de police. Invitée le 6 janvier dans la matinale de RMC et BFMTV, la députée Mathilde Panot se retrouve bombardée de « questions » par la journaliste Apolline de Malherbe, dans une séquence qui s’apparente à une tentative d’extorsion d’aveux. Entendu dans les locaux de RTL par l’inspecteur Thomas Sotto, le coordinateur de la France Insoumise et député Manuel Bompard est à son tour sommé de cracher le morceau.
Les interviews, mélange d’intimidation et de pratiques inquisitrices, virent au grotesque. Ainsi, après avoir tourné autour du pot en évoquant la « répression » du gouvernement vénézuélien à l’encontre de son peuple, Apolline De Malherbe finit enfin par prononcer la phrase qui lui brule les lèvres : « Je vous demande simplement en fait si Maduro est un dictateur ? ». A partir de là, tel un chien de garde déchainé, plus rien ne l’arrête. « J’ai vérifié et vous n’avez jamais dit – oublions la question de Donald Trump – vous n’avez jamais dit dans les dernières semaines, les derniers mois ou les dernières années que Maduro était un dictateur ». Puis, au cas où Madame Panot n’aurait pas compris, la journaliste insiste : « Est-ce que vous considérez, nonobstant la question de Trump, que Maduro n’a jamais été un dictateur ? ». Refusant légitimement de se soumettre aux coups de pression de Mme de Malherbe, Mathilde Panot essaie tant bien que mal de rappeler qu’il s’agit avant tout dans cette affaire d’une agression impérialiste des États-Unis, du viol de l’intégrité territoriale d’un pays souverain, de l’enlèvement de son président, du piétinement du droit international… Mais de tout cela, Apolline de Malherbe n’a cure. Peu importent les faits, les arguments et l’analyse de son invitée, la journaliste semble emportée dans un tel délire qu’elle ne voit et n’entend plus rien. D’où cette conclusion qui se passe de tout commentaire : « J’ai bien compris qu’effectivement vous ne voulez pas qualifier Nicolas Maduro de dictateur ».
Même son de cloche dans la matinale de RTL. A ceci près que, contrairement à sa consœur de RMC, Thomas Sotto – sans doute pressé par le temps – démarre l’interview tambour battant. « Il faut sans doute distinguer le fond et la forme mais pour commencer sur le fond : la chute de Nicolas Maduro est-elle une bonne nouvelle pour le Venezuela et pour la démocratie dans le monde ? ». Manuel Bompard n’a alors droit qu’à vingt petites secondes pour rappeler qu’il s’agit d’un kidnapping. Vingt secondes de trop pour M. Sotto, trépignant d’impatience de balancer la réplique rondement préparée : « C’était un dictateur, Maduro ». Essayant de rappeler les ambitions expansionnistes de Donald Trump et la menace qu’il fait peser sur la sécurité d’autres territoires, à commencer par le Groenland, M. Bompard se fait rappeler à l’ordre sur-le-champ : « Sauf, M. Bompard que le Groenland n’est pas dirigé par un dictateur ». Tiens d’ailleurs, « est-ce que Maduro est un dictateur ? » renchérit le journaliste. Tels des enfants de trois ans disposant de peu de mots de vocabulaire, les journalistes semblent incapables de formuler une question sans qu’apparaisse le mot « dictateur ». Face à cette déchéance intellectuelle et morale, on oscille entre la consternation et le rire.
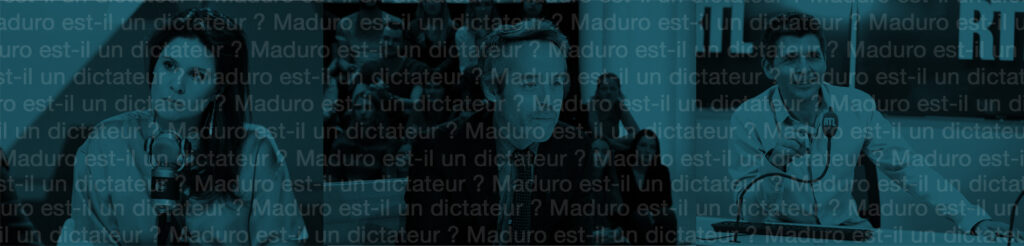
Chez Quotidien, théâtre de la grande messe libérale et progressiste, cela fait bien longtemps qu’on s’est érigé en grand défenseur de l’Occident démocratique et de ses célèbres « valeurs ». En croisade contre les régimes illibéraux et autoritaires, la troupe de journalistes, pétrie de vertu morale et de convictions humanistes, ne rate jamais une occasion de dénoncer le danger que fait peser La France Insoumise sur notre pays. Régulièrement accusé de complaisance avec la Chine et la Russie, Jean-Luc Mélenchon est la cible prioritaire de cette petite bourgeoisie de gauche, porte-voix d’une social-démocratie à l’agonie. Après avoir opiniâtrement bataillé, en vain, pour faire dire aux Insoumis que le régime de Pékin est bel et bien une dictature, voilà que l’actualité vénézuélienne leur offre une formidable occasion de s’adonner à leur passe-temps favori. Lors de l’émission du mercredi 7 janvier 2026, après seulement onze minutes et trente secondes, Yann Barthès met fin à un suspense insoutenable et pose LA question que tout le monde attend : « Et pour finir, une question, Nicolas Maduro est-il un dictateur ? ». Interrogation faussement naïve à laquelle le chroniqueur Julien Bellver répond avec un sens remarquable de la nuance : « C’est assez simple de répondre à cette question quand on est démocrate ». Sous-entendu, la France Insoumise ne l’est pas. « Oui le président du Venezuela est un dictateur qui terrifie son peuple mais quand on est à LFI c’est visiblement plus compliqué. Tous les cadres insoumis interrogés dans les médias refusent de reconnaitre cette réalité. Les masques tombent ». Preuve à l’appui, le chroniqueur diffuse les extraits des interviews… de Mathilde Panot et de Manuel Bompard. La boucle est bouclée. Ou presque. Puisque Julien Bellver tient en effet à parachever sa brillante démonstration par ces mots : « Pour conclure, revenons donc à la question initiale : Nicolas Maduro est-il un dictateur ? La réponse semble être non pour les Insoumis ». Ce ne sont là que quelques exemples du traitement unanime d’un système médiatique qui n’en finit pas de sombrer.

Cadrer et discipliner : l’art du « framing »
Mais au fait, Nicolas Maduro est-il un dictateur ? Nous ne répondrons évidemment pas à cette question qui, selon nous, est dénuée de toute pertinence. Ouvertement polémique, elle constitue un piège dans lequel il serait idiot et naïf de tomber. Dans le cas vénézuélien, il s’agit pour les médias d’imposer un cadrage strict et contraignant dont l’objectif est double : justifier l’attaque des Etats-Unis et dépeindre la gauche critique en alliée des régimes tyranniques. Les termes du débat étant faussés, accepter cette question reviendrait à la légitimer. Y répondre, c’est consentir à aller sur le terrain de l’adversaire et se soumettre à ses règles du jeu. Y répondre, c’est prétendre que les journalistes font simplement et honnêtement leur travail, oubliant qu’ils agissent ici en militants politiques zélés.
Ce procédé porte un nom : le « framing » (« cadrage », en francais). D’abord théorisé par le sociologue Erving Goffman, qui le définissait comme une méthode par laquelle des individus appliquent des schémas d’interprétation pour classifier et interpréter les informations qu’ils rencontrent, ce n’est que dans les années 1990 que ce concept est transposé aux médias. L’auteur étatsunien Robert Entman explique alors que « cadrer, c’est sélectionner certains aspects d’une réalité perçue pour les mettre davantage en évidence de manière à promouvoir une définition particulière du problème, une interprétation causale, une évaluation morale, ou une recommandation de traitement pour l’élément décrit ». En choisissant volontairement de mettre l’accent sur la nature du régime vénézuélien, les journalistes entreprennent sciemment d’orienter le citoyen en occultant ce qui constitue pourtant la seule information digne d’être traitée : l’agression brutale d’un État souverain et les velléités impériales d’un président radicalisé. Cette approche enferme l’opinion publique dans une vision étriquée de la réalité.
Il faut reconnaître toutefois que la technique est plutôt subtile. En effet, à défaut d’applaudir ouvertement la politique de Donald Trump et ainsi apparaître comme de vulgaires larbins, les journalistes procèdent à un renversement total de la réalité. Quand M. Sotto distingue le « fond », la chute de Maduro, et la « forme », l’invasion militaire, il sous-entend clairement que l’attaque étatsunienne est une information secondaire, presque anecdotique. Plus loin, lorsqu’il refuse la comparaison entre le cas vénézuélien et ce qui pourrait advenir au Groenland sous prétexte que l’un est une « dictature » et l’autre une démocratie, il justifie l’interventionnisme étatsunien et la sinistre politique de changement de régime. Par ailleurs, il s’agit de donner l’illusion de la critique en affichant une certaine réprobation quant à la « méthode ». Ce n’est donc pas l’hubris coloniale et dominatrice que l’on remet en cause, mais simplement la manière (un peu forte) avec laquelle M. Trump opère. Le personnage du président – vulgaire et brutal – est une aubaine pour la bonne conscience médiatique. Raisonnable, modérée, nuancée, elle peut ainsi jouer la carte de l’indignation tout en souscrivant à la politique extérieure étatsunienne.
« Enbedding »… dans le narratif étatsunien
Ce qui est particulièrement frappant dans ce traitement médiatique, c’est qu’il tend à imposer un discours et à véhiculer des représentations parfaitement en phase avec le narratif de l’administration étatsunienne. En répétant qu’il s’agit d’une simple « capture » de Nicolas Maduro, en présentant l’opération comme une formidable démonstration de force, et l’attaque comme « chirurgicale », qui n’aurait causé aucun mort, la presse devient la courroie de transmission de la propagande militaire. On peut parler ici d’une forme d’embarquement (« embedding » en anglais).
Ce concept, qui apparaît en 2003 lors de la guerre en Irak, désigne l’intégration à l’armée étatsunienne de journalistes (près de 700) qui suivent les opérations sur le terrain et montrent à l’opinion publique une partie de la réalité que les militaires leur permettent de documenter. Cette intégration peut être définie comme « une approche disciplinaire qui agit comme un appareil de normalisation des cas problématiques avec une visée avant tout corrective et non répressive »1.
C’est précisément ce qui se passe dans le cas du Venezuela. En effet, bien qu’ils n’aient pas été conviés à l’opération, les journalistes pratiquent une forme de journalisme de guerre en intégrant la même rhétorique, les mêmes éléments de langage et in fine les mêmes mensonges diffusés par le pouvoir. L’approche disciplinaire consiste à ramener dans le droit chemin quiconque effectuerait une sortie de route en s’aventurant à parler d’autre chose que le problème identifié par les médias : la « dictature » de Maduro. Comme à chaque expédition punitive décidée par un Etat occidental, les journalistes enfilent leurs plus beaux treillis et se muent en parfait messagers de guerre. Hier sur le Vietnam et l’Irak, aujourd’hui sur la Palestine, le Venezuela et l’Iran, demain sur Taïwan, la servilité de la presse n’a d’égales que son hypocrisie et sa lâcheté.
Défaire le mythe démocratique
De quoi tout cela est-il le nom ?
L’obsession de la doxa pour qualifier négativement tout régime hostile à l’Occident est loin d’être anecdotique : elle constitue une des dernières parades permettant à nos régimes démocratiques de proclamer leur supériorité civilisationnelle et morale. Contesté de toutes parts, pointé du doigt pour sa complicité et son soutien à des politiques criminelles comme à Gaza, l’Occident se drape dans les habits démocratiques pour mieux mettre en scène son éternelle innocence. L’opposition dictature vs démocratie est un moyen de rejouer à nouveaux frais l’antagonisme entre un « Nous » et un « Eux », entre le Nord et le Sud, entre le centre et la périphérie. La justification de l’invasion du Venezuela n’est donc pas seulement le signe d’un asservissement à la puissance des Etats-Unis, elle procède aussi d’une forme de nostalgie pour l’ordre impérial d’antan.
« Démocratie » est devenu le nom générique justifiant l’écrasement par l’Occident de tout ce qu’il considère comme « autre », comme ennemi. La simple évocation du qualificatif « démocratique » suffit à vous absoudre de vos crimes. Il constitue un gage de pureté, et donc d’impunité. Le cas d’Israël est de ce point de vue emblématique. Quiconque, en effet, tente de rappeler les innombrables atrocités commises depuis des décennies et de manière encore plus massive depuis octobre 2023, se voit systématiquement renvoyé au fait qu’Israël, contrairement à ses voisins, jouit d’un régime politique similaire à celui de l’Europe et des Etats-Unis. Il ne peut donc être que fondamentalement bon. Être « démocrate », c’est ainsi bénéficier d’un blanc-seing et d’un permis de tuer. Erigée en religion civile, la « démocratie » fonctionne comme un régime de croyance auquel chaque citoyen est sommé de se plier. Douter, s’interroger, c’est être assimilé à un dangereux mécréant. Dès lors, dénoncer la politique israélienne, c’est s’attirer les foudres des soutiens de Tel Aviv, qui n’hésitent pas à faire de vous des alliés objectifs du « terrorisme » et des « antisémites » en puissance.
Une « démocratie pour le peuple des seigneurs »
En réalité, les faits ne comptent pas. Peu importe qu’Israël ne traite aucunement ses citoyens sur un pied d’égalité, que le pays se soit déclaré en 2018 « Etat nation du peuple juif », qu’il piétine les règles les plus élémentaires de l’Etat de droit, qu’il impose un régime d’apartheid, qu’il occupe, colonise, génocide un peuple, qu’il se rende coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité, qu’il généralise les « détentions administratives », qu’il emprisonne et tue les journalistes, qu’il institutionnalise la torture et qu’il prévoie bientôt de rétablir la peine de mort… On nous rétorquera qu’Israël est une « démocratie vivante », comme l’attestent les manifestations monstres contre la réforme judiciaire voulue par Netanyahou.
Ces mobilisations n’étaient en réalité que l’expression d’un peuple d’enfants gâtés, accrochés à leurs propres droits et leurs seules libertés, indifférents envers ce qui devrait constituer la cause des mobilisations dans une démocratie digne de ce nom : la colonisation d’un peuple et le spectre de sa disparition. Les manifestants anti-Netanyahou représentent cet esprit typique des classes moyennes libérales, soucieuses de préserver leur bonne conscience démocrate. Au fond, ils ne font que défendre ce que l’historien marxiste Domenico Losurdo appelait une « démocratie pour le peuple des seigneurs ».
C’est pourquoi tout anti-impérialisme conséquent se doit de mener un combat intellectuel et politique contre cette forme de religion civile que constitue l’invocation de la démocratie. Comme l’écrit très justement le philosophe Alain Badiou, « la seule critique dangereuse et radicale, c’est la critique politique en acte de la démocratie. Parce que dans nos pays, l’emblème du temps présent, son fétiche, c’est la démocratie ». La séquence qui vient de s’écouler nous l’a une nouvelle fois parfaitement démontré.
- Samuel Lamoureux, Et si le cadrage des journalistes provenait de l’encadrement des journalistes, Les Cahiers du journalisme, N°3, Premier semestre 2019. ↩︎

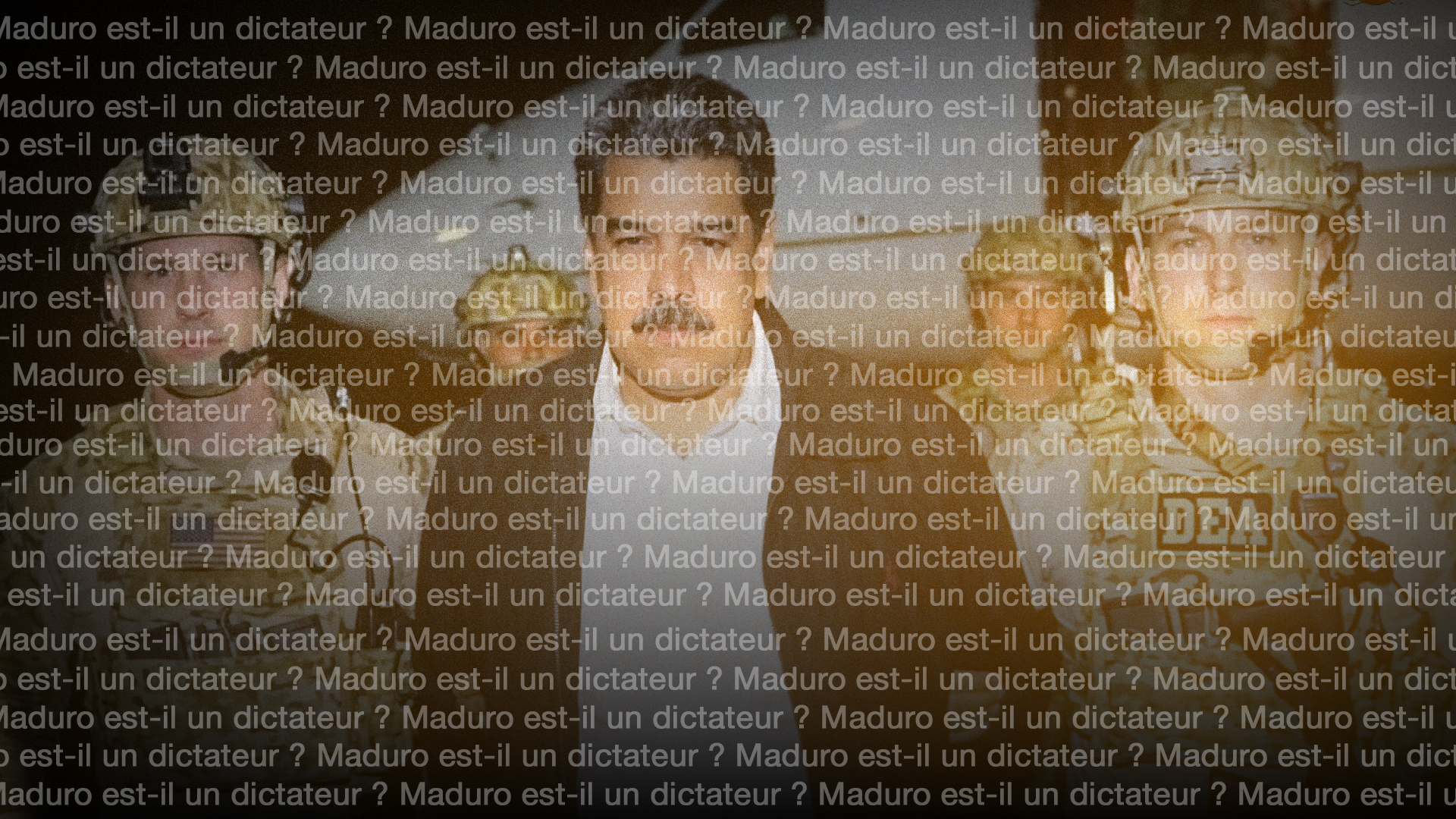
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.