Le film Sirāt du réalisateur franco-espagnol Oliver Laxe a été projeté en compétition lors de l’édition 2025 du festival de Cannes, où il s’est trouvé honoré d’un prix du jury. À l’instant où ces lignes sont écrites, il vient en outre d’être nommé pour l’Oscar de la meilleure réalisation étrangère par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – de même qu’à de nombreux autres prix à l’international. D’une manière générale, le film a ainsi reçu un accueil critique gros de superlatifs louangeurs. Il faut pourtant bien le dire : derrière l’esbrouffe, il s’agit là d’un parfait ratage, dont l’ampleur est proportionnelle à sa grandiloquence.

Fausse épopée, vrai nihilisme
Il se dit que sur la Croisette, l’année dernière, on n’osait parler de Sirāt qu’à demi-mots, avec cette pudeur mêlée de l’effroi fasciné que l’on réserve aux œuvres intimidantes du génie. Dans cet objet cinématographique, pourtant, tout sonne faux – n’en déplaise à la quasi-unanimité sidérée des critiques. La première partie déjà (car le film en comporte deux, assez nettement divisées) ; celle-ci semble ambitionner de réinvestir le motif épique de la quête initiatique : plongé dans des rumeurs de fin du monde, un père (Luis, incarné par Sergi López) accompagné de son jeune fils, erre à la recherche de sa fille aînée ayant pris le large, dans une rave perpétuelle située quelque part au milieu du désert marocain.

Alors que tout est fait pour nous signifier la profondeur et l’intensité de cet univers qui se déploie devant nos yeux, on n’adhère à aucun moment à l’esthétique totalisante, faussement cradingue, construite à grands coups d’emphase sonore et visuelle (photographie vintage à l’étalonnage saturé, nappes continues d’une musique techno étrangement peu efficace) – pas plus, et c’est plus grave, qu’aux personnages, une bande de teufeurs en carton-pâte dont, même si, à ce qu’il paraît, M. Laxe est réellement allé les chercher dans quelque teknival, nous ne pouvons nous empêcher de nous dire qu’ils sont bien poseurs. Qu’il s’agisse de la pauvreté vertigineuse des dialogues, du maniérisme de la direction d’acteurs, ou peut-être de celui, malheureusement spontané, de ces acteurs non professionnels : quoi qu’il en soit, tout cela se prend fort au sérieux, et paraît d’autant plus grotesque.
Mais le véritable visage de M. Laxe – son visage de réalisateur, cela va sans dire – se révèle dans la deuxième partie du film, à partir d’une scène-bascule à laquelle en fait tout nous conduisait depuis le début. Nous comprenons lorsque celle-ci intervient que la piste de l’épopée se déployant au sein d’un univers désertique, amorcée durant la première partie, n’était qu’un leurre devant permettre à M. Laxe d’amener un public de bonne foi à venir assister à l’étalage de son nihilisme d’adolescent tyrannique lorsque celui-ci tue brutalement le personnage du fils dans une scène si improbable qu’elle a pour effet de rompre immédiatement le pacte fictionnel (déjà bien abîmé, il est vrai) qui relie normalement le cinéaste à son spectateur. On rit, mais on rit jaune, non pas tant parce qu’on serait choqués par la violence de ce que l’on nous montre (en ce premier quart de XXIe siècle, il en faut malheureusement un peu plus), mais parce qu’on comprend alors que, pour avoir le culot de nous montrer cela, le réalisateur nous est résolument hostile.

Mobiliser un langage hostile envers quelqu’un avec l’intention unique de le heurter, que le but soit atteint ou non, cela est constitutif d’une injure. Après avoir ainsi injurié son spectateur, si celui-ci est resté sur son siège, M. Laxe le sait ferré pour de bon. On est alors gagné par le sentiment désagréable d’être livrés à l’imagination d’un réalisateur pervers qui, comme tout pervers, sait procéder par étapes afin de semer le trouble dans l’esprit de sa victime, brouillant progressivement le seuil de l’acceptable et de l’inacceptable – avant de passer soudainement à la vitesse supérieure. Le ridicule dans lequel s’affaisse le film croît à proportion de sa violence. Le cinéaste entreprend en effet dans cette seconde partie de pulvériser les membres de son petit groupe teknivaliers – entendant ainsi vraisemblablement soumettre, dans une métaphore à la subtilité pachydermique, la conscience occidentale à une tonique séance d’autoflagellation –, les uns après les autres, longuement, les ayant menés au milieu d’un champ de mines antipersonnel.
Champ de mines où l’on nous demande de croire que ceux-ci, escortant Luis dans sa quête, auraient trouvé bon de monter le camp pour une dernière petite dose de musique techno sous psychédéliques afin de se remettre du trépas de l’enfant. Dans cette invraisemblance s’engouffre d’ailleurs toute la faiblesse du film : comme s’il était crédible que l’existence de vastes territoires minés par l’armée marocaine dans le Sahara occidental (dont le film présuppose bien paradoxalement le caractère de réalité factuelle, c’est-à-dire historique et politique, sans quoi il ne pourrait avancer un tel ressort scénaristique) dans sa lutte contre les indépendantistes du Front Polisario fût ignorée de baroudeurs dont la vie consisterait à en arpenter les étendues. Mais c’est là évidemment une considération de vraisemblance bassement réaliste n’effleurant même pas M. Laxe – qui, tout à son mysticisme benêt, n’en est, il est vrai, pas à cela près. Chez Laxe, la mort violente survient par hasard (or cela, là encore, est faux), sans raison, abstraitement.

Abstraction et désintégration
Georg Lukács a examiné dans sa Théorie du roman (1916) les possibilités de la fiction narrative à l’époque, disait-il après Fichte, du « péché accompli » (ou en des termes plus prosaïques, celle de la désintégration des liens sociaux organiques par la modernité marchande). Il a, ce faisant, insisté sur l’équilibre précaire que doit maintenir ladite fiction afin de se situer à la hauteur de sa tâche, dans la mesure où elle doit entreprendre, pour le dire en un mot, de donner une forme esthétique à la fausseté et à la disharmonie informe du monde de l’expérience vécue dans de telles conditions historiques.
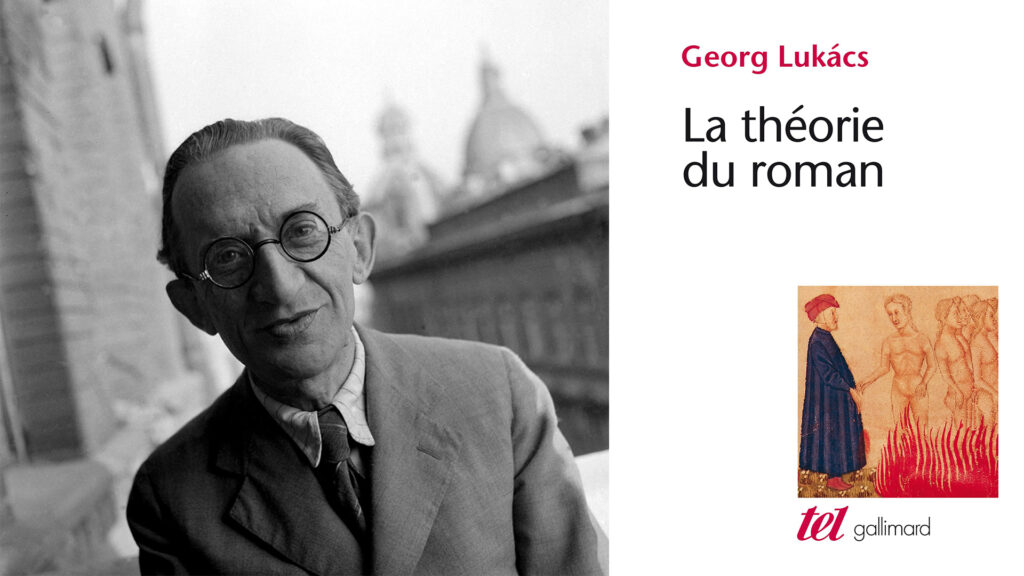
La première menace, disait Lukács, guettant une œuvre de fiction qui ne parviendrait pas à maintenir un tel équilibre est justement l’abstraction – c’est-à-dire la perte de contact avec le réel. Une œuvre, par exemple, qui entreprendrait de produire immédiatement l’image d’un monde harmonieux serait condamnée à sombrer dans le lyrisme béat (pensons à Yves Bonnefoy ou à d’autres mauvais poètes) ou la niaiserie idyllique (pensons à Emmanuel Mouret ou aux Teletubbies). Mais l’on peut aussi penser à tant d’œuvres d’heroic fantasy qui (à l’inverse de ce que parvient régulièrement à faire la science-fiction) refusant de s’affronter à la réalité du monde contemporain, n’ont à proposer que la régression névrotique dans un univers faux et suspect de valeurs soi-disant immémoriales.
La seconde menace est celle de la désintégration. Elle surgit dans le cas inverse où l’œuvre se contenterait de refléter directement l’absurdité et la dislocation chaotique de l’existence moderne sans entreprendre de les élaborer dans une fiction narrative structurée, dotée d’une cohérence interne et indiquant par là, dans sa forme même, la possibilité d’un dépassement de cette vie désagrégée. En renonçant à l’élaboration de la réalité, l’art renoncerait aussi, si l’on peut dire, au rachat de celle-ci par la construction esthétique. S’ouvre alors quelque chose comme ce qu’Hegel avait appelé en son temps le champ de « l’art ironique », où les artistes – poètes, romanciers, dramaturges, mais cela vaut bien sûr aussi pour les cinéastes, mutatis mutandis – ne font finalement plus qu’exposer leur propre atomisation, en en retirant par ailleurs une jubilation sadique proportionnée à leur exhibitionnisme.
Dans Sirāt, Oliver Laxe réussit la prouesse de succomber simultanément à ces deux vices esthétiques. La première partie, mettant en scène cet univers pseudo-épique de désert et de transe (dans lequel l’humanité occidentale renouerait avec son être tellurique) se vautre dans le premier écueil, celui de l’abstraction. La deuxième partie, qui voudrait précisément abjurer cette illusion en la démolissant avec cruauté, ne fait que venir se briser sur le second écueil, celui de la désintégration ironique – assez littéralement pour qu’il ne soit guère besoin de l’expliciter. La partie finale, où l’on nous montre le héros parvenant, au terme de sa via crucis, à rejoindre sa propre humanité, rechute enfin dans l’abstraction, potentialisée par ce détour dans le slasher nanardeux (mais ne s’assumant pas comme tel, c’est bien le problème) qui sape l’unité fictionnelle jusque dans ses fondements.
Le réel : le voir ou le nier
À propos de cette question du lien entretenu par la fiction cinématographique avec la réalité au sein de laquelle elle émerge et intervient, la nullité de Sirāt devient plus criante encore si on la compare à une autre réalisation diffusée elle aussi pour la première fois lors de l’édition 2025 du festival de Cannes, Le Rire et le couteau, du cinéaste portugais Pedro Pinho. On reconnaîtra ici deux manières résolument antagoniques que le cinéma européen peut avoir de se rapporter à la présente situation sociale-historique, qu’il faut bien nommer postcoloniale, des pays africains.

Le film de Pinho met en scène les heurs et malheurs d’un certain Sérgio (incarné par Sérgio Coragem), employé lusitanien d’une ONG arrivant en Guinée-Bissau et commissionné à la production d’un rapport sur la viabilité d’un projet d’infrastructure routière financé par l’aide internationale. Il se trouve confronté sur place tout à la fois aux luttes de pouvoir, à la corruption et à la violence auxquelles sa situation l’expose, mais aussi à la marge d’une population urbaine au sein de laquelle il découvre un monde de fête, de désir, de joies et de tourments, de même qu’à la misère d’une population rurale qui, elle, nous est présentée comme tenaillée entre une situation matérielle invivable et l’attachement à des traditions venant se télescoper avec la réalité ambivalente du monde contemporain, porteur de destruction autant que de la possibilité du progrès. À travers le regard qu’il porte sur ce personnage européen profondément ambivalent, parce que saisi dans les mille contradictions – politiques, morales et pulsionnelles – dans lesquelles se tisse son existence, le réalisateur parvient à traiter de la réalité de l’Afrique contemporaine dans son épaisseur et sa viscosité. Et cela sans jamais donner dans la condescendance ni l’autocritique didactique et lénifiante, non plus que dans le fatalisme ou une quelconque forme d’angélisme. Le Rire et le couteau se tient toujours sur une ligne de crête, sans trébucher, et parvient ainsi à se constituer comme une œuvre au réalisme exigeant.
Chez M. Laxe, si certains détails assez précis de cette même réalité peuvent être convoqués çà et là de façon arbitraire – et, partant, révélatrice – pour fournir les ressorts scénaristiques grotesques que nous avons dits, celle-ci est en vérité éludée, barrée, écrabouillée par ses rêveries d’extase apocalyptique d’esthète petit-bourgeois, las de lui-même et de son monde – monde, il est vrai, bien crépusculaire. Comme ses personnages, d’ailleurs, M. Laxe propose d’abord de trouver dans le désert saharien (peuplé, malgré tout, d’hommes et d’histoire) une surface vierge, un lieu vide dans lequel pourraient trouver refuge les rebuts d’un homo europaeus en errance. En massacrant rageusement ensuite ces mêmes personnages, et avec eux sa propre illusion désavouée, il ne fait que mettre en scène, mais bien trop fatuitement, la fracture intérieure d’une conscience occidentale confrontée à la nécessaire déception de ses fantasmes de lointains exotiques, et condamnée à retrouver sur tous les rivages qu’elle atteint la désespérance et le désir de mort qui constituent son lot. Le final mystico-politique du film, où l’on voit en somme l’Homme blanc, ayant traversé l’enfer, renaître à soi et à son propre dénuement pour ne faire plus qu’un avec une cohorte de migrants déshérités, porte l’irréelle obscénité du film à un point d’apothéose.
Comme les critiques l’ont donc dit presque d’une seule voix, Sirāt constitue bien, ainsi, un événement. Mais contrairement à ce que ceux-ci (qui ont peut-être partagé trop de coupettes de champagne avec M. Laxe dans les afterparties du festival pour conserver la lucidité de leur jugement) ont affirmé, non au sens où l’on pourrait y reconnaître une œuvre visionnaire. Il s’agit plutôt d’un signe des temps : le temps du règne du faux, où la grossièreté, la boursouflure et la cuistrerie peuvent se parer en esprit, audace et profondeur, sous un grand bruit d’acclamations.


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.