Vous étudiez la structuration de la société et la compétition politique en analysant la constitution de blocs sociaux. Vous expliquez par exemple que l’élection d’Emmanuel Macron en 2017 est liée à la fédération d’un bloc bourgeois, ou que les résultats des dernières législatives ont mis en exergue l’existence de trois blocs. Avant d’entrer dans le détail de vos analyses, pourriez-vous définir ce qu’est un « bloc social » ?
Ce que nous appelons un bloc social, c’est une alliance de fait entre des groupes socio-politiques. Nous définissons un groupe socio-politique sur la base des attentes qu’il porte, ce qui implique qu’il peut être sociologiquement hétérogène : ceux qui y appartiennent expriment le même type d’attentes sur les politiques publiques et le devenir social. Un bloc social est une alliance de fait entre différents groupes, qui n’est pas liée à un compromis ou un accord négocié, mais au fait que ces groupes se reconnaissent, pour des raisons en principe variées, dans un même type de proposition politique. C’est pour cela que l’on affirme que c’est la stratégie politique qui agrège les blocs. Une stratégie politique propose des choses à la fois du point de vue idéologique et des choses plus concrètes quant aux politiques publiques. Cette stratégie peut satisfaire des attentes différentes, et donc les groupes qui portent ces attentes se retrouvent ensemble à soutenir cette stratégie. C’est cette alliance de fait que l’on appelle un bloc social, cet ensemble de groupes socio-politiques qui soutiennent la même stratégie pour des raisons éventuellement différentes.
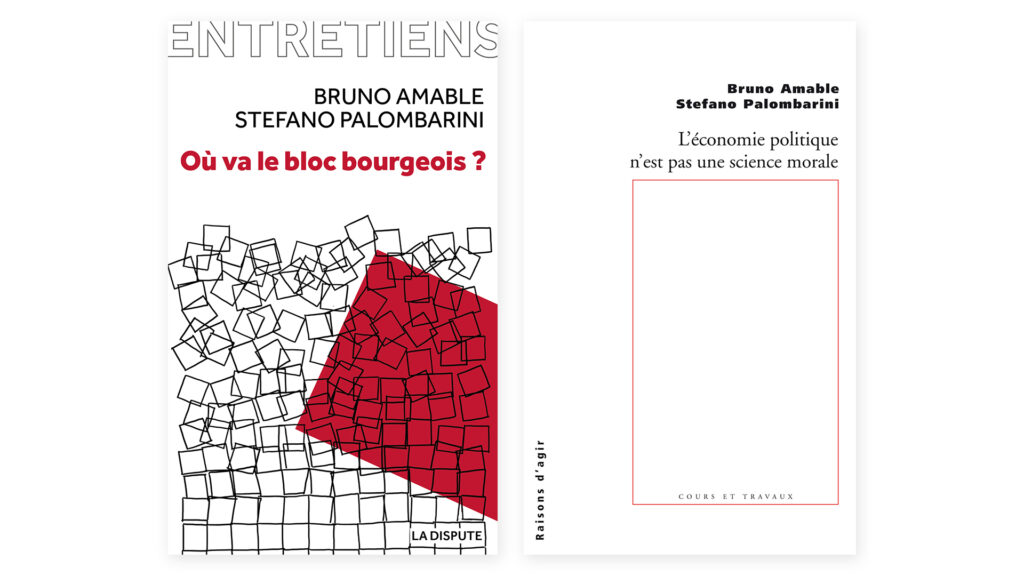
Le bloc social est donc défini par une action commune, par exemple le fait de voter de la même façon, pas nécessairement par un intérêt objectif commun.
Non, ce ne sont pas forcément des groupes qui partagent le même intérêt qui forment un bloc social, mais ils soutiennent la même stratégie politique. Le soutien électoral est l’une des composantes du soutien politique, il y en a d’autres. La puissance politique de différents groupes, c’est-à-dire la capacité à apporter un soutien politique, n’est pas distribuée en fonction de la taille des groupes. Des groupes très petits, comme celui des grands industriels par exemple, peuvent avoir une capacité très forte à produire du soutien, par le contrôle des médias ou leur capacité à menacer de délocaliser ou de stopper la production. L’importance de la dimension électorale varie ainsi selon les contextes. On essaie dans le livre de proposer une méthode de travail qui pourrait être appliquée à des situations très différentes.
À titre d’exemple, Manuela Mahecha Alzate, une doctorante qui soutiendra bientôt sa thèse, a appliqué notre grille d‘analyse à la Colombie. Le vote a une incidence sur le soutien politique en Colombie mais quasiment à la marge, ce n’est pas la variable décisive, alors que c’est une variable très importante en France. En Colombie, les cartels ont une capacité très forte à influer sur la production de soutien politique. On peut dire la même chose de la place de l’armée dans de nombreux pays d’Amérique latine. Le soutien de l’armée est absolument décisif dans des pays où la démocratie est fragile et la possibilité d’un coup d’État toujours présente. On ne peut pas exclure à 100% la possibilité d’un coup d’État en France mais ça reste quelque chose de tout à fait minime. C’est pourquoi en France le fait de proposer une stratégie qui déplaît à l’armée n’est pas un obstacle énorme. Le soutien politique des institutions internationales peut aussi être important. Si l’on prend l’exemple de la Grèce, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne ne sont pas composés de gens qui votent en Grèce, mais leur soutien ou leur absence de soutien changeait tout du point de vue de la stratégie politique de Tsipras. En France aussi, une politique qui rencontrerait l’opposition de la Banque centrale européenne ou de la Commission européenne connaîtrait des difficultés, même si elles ne seraient pas du même ordre que dans un pays plus petit et plus isolé comme la Grèce. C’est pour cela qu’on ne réduit pas le soutien politique au soutien électoral. On peut gagner une élection, comme ça a été le cas de Tsipras, et ensuite voir entraver sa stratégie par des agents qui, électoralement, n’ont aucun poids.
Vous vous situez dans un courant de l’économie politique dit « néoréaliste », qui explique la politique par l’économie sans être réductionniste ni fonctionnaliste. Vous insistez sur le fait que la politique ne découle pas seulement des intérêts ou des actions immédiates du capital mais qu’elle répond à des volontés d’accumulation politique. Pouvez-vous expliquer ?
On a consacré un chapitre entier à l’autonomie du politique, l’autonomie par rapport à l’économie, qui nous différencie à la fois des approches néo-classiques ou néo-libérales et des approches marxistes. Il y a certes des approches plus sophistiquées que d’autres dans le marxisme, certaines peuvent reconnaître une certaine autonomie au politique, mais qui est toujours une autonomie relative. Par exemple, l’analyse de l’État par Poulantzas est très sophistiquée, et ce qu’il appelle « le politique » est en fin de compte l’État. L’autonomie qu’il lui attribue est liée au fait que la fonction de l’État est la défense de l’intérêt à long terme de la classe capitaliste en tant que classe. L’autonomie est donc double. D’une part, la défense de l’intérêt de long terme signifie que l’action étatique peut aller contre des demandes immédiates des capitalistes. Et d’autre part, la défense des capitalistes en tant que classe peut pousser l’État à agir contre les intérêts spécifiques de certaines fractions spécifiques de cette classe. L’autonomie qu’il attribue à l’État est donc importante, mais il s’agit encore d’une approche fonctionnaliste. Selon Poulantzas, l’État a une fonction qui découle, même si de façon complexe, de la protection d’intérêts qui se définissent dans la structure productive.

À l’inverse, il n’y a aucun fonctionnalisme dans l’approche que l’on propose avec Bruno Amable. On parle de modèles théoriques, il ne s’agit pas de dire qu’une approche est vraie et l’autre fausse, mais on trouve plus productif, plus fertile, de construire une approche qui n’attribue pas une fonction spécifique au politique, et qui pense le politique comme un champ autonome gouverné par sa logique propre, à savoir la logique de l’accumulation politique, qui est une accumulation distincte de l’accumulation économique. On ne dit pas que ce sont les acteurs politiques qui visent l’accumulation politique, il ne s’agit pas de motivation individuelle. Ce que l’on dit, c’est que la stratégie qui s’impose est objectivement celle qui parvient à produire le soutien politique le plus fort, qui encore une fois n’est pas seulement un soutien électoral.
Il se peut que certains acteurs intègrent la logique du champ comme leur unique finalité individuelle, ce qui engendre ce qu’on appelle de l’électoralisme dans le langage courant. Mais les acteurs politiques ne font pas tous de l’électoralisme au sens le plus bas du terme. Ils peuvent avoir d’autres objectifs, un engagement personnel en faveur de certains intérêts. Beaucoup d’acteurs politiques à gauche ont sincèrement à cœur les intérêts des dominés. D’autres peuvent avoir d’autres objectifs, comme le Parti socialiste de Hollande qui travaillait à la transition vers le capitalisme néo-libéral. Mais les mesures défendues par Hollande comme la loi Travail ont fait que sa stratégie a échoué, à tel point qu’il n’a pas pu se représenter à la fin de son mandat présidentiel. Indépendamment des finalités poursuivies par les acteurs politiques, qui peuvent être très diverses, une stratégie s’impose durablement quand elle parvient à accumuler du soutien, et elle échoue si elle n’y arrive pas.
En disant tout cela on rompt donc avec le fonctionnalisme, et en même temps, on dit aussi que du point de vue de la production du soutien politique, les intérêts économiquement dominants ont quand même une puissance très particulière, par le contrôle de la production, le contrôle des médias, le contrôle d’une grande partie de la production intellectuelle et culturelle, etc. Il ne s’agit donc pas de tenir un discours à l’ancienne sur le pluralisme où l’on considérerait les capitalistes comme un groupe parmi d’autres. Dans la production du soutien politique, les capitalistes jouent un rôle très fort, mais on peut aussi concevoir la possibilité d’un bloc social dominant dans lequel la classe dominante d’un point de vue économique ne serait pas centrale, voire ne serait pas présente du tout. Ce n’est pas une possibilité qu’il faut exclure théoriquement.
Vous considérez par ailleurs que le pantouflage, c’est-à-dire le fait de passer d’une fonction politique au travail pour une entreprise privée, expliquerait que des ministres puissent se dire « pro business »… Vous pouvez en dire plus ?
Dans un contexte de crise politique, donc de difficulté à agréger un bloc dominant, de difficulté à poursuivre une stratégie qui s’impose durablement et produit durablement du soutien, une des conséquences est que l’aptitude du personnel politique change. Il y a cinquante ans, des responsables aussi bien de droite que de gauche avaient en tête l’idée que leur avenir était dans la politique. La stratégie de Jacques Chirac s’insérait par exemple dans une période longue, celle du bloc de droite de l’époque, et Mitterrand, dans les années 70, se situait aussi dans une perspective longue avec le bloc de gauche, de prise du pouvoir, de gouvernance, etc. Quand ces blocs s’effondrent, quand il n’y a plus de bloc dominant sur lequel fonder son action – puisqu’il y a eu ensuite le bloc bourgeois mais qu’il est aussi en train de s’écrouler – l’horizon n’est plus lié aux décennies qui viennent, il est beaucoup plus proche.
Le fait d’occuper un rôle majeur dans la politique est désormais un emploi précaire qu’on peut rentabiliser en servant de vitrine, en le transformant en occasion de se constituer un carnet d’adresses ou en favorisant certains acteurs pour obtenir ensuite quelque chose en retour. Et évidemment, si l’on est ministre de l’économie en se disant qu’on travaillera ensuite dans une grande entreprise, cette idée peut avoir une incidence sur les décisions qu’on prendra. En visant la proximité avec une grande entreprise on a une attitude différente de celle d’une personne qui envisagerait de se présenter à la présidentielle dans cinq ou dix ans. En miroir, le fait que les carrières politiques sont désormais plus courtes favorise la tendance à aller chercher les responsables politiques dans le privé. Tout cela engendre des allers-retours entre le public et le privé qui sont une conséquence de la crise politique, de l’effondrement des anciens blocs sociaux et de l’absence aujourd’hui d’un bloc social dominant.
Vous venez de distinguer ce que vous appelez un « bloc de droite » du « bloc bourgeois », celui qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir. Vous pouvez expliciter la différence ?
Le bloc de droite était le bloc dominant traditionnel dans le paysage politique français. Il a été concurrencé par un bloc de gauche à partir des années 70 mais l’histoire du bloc de droite est plus ancienne. Le bloc de droite agrège une composante importante de la bourgeoisie mais aussi une composante importante des classes populaires, notamment la quasi-totalité des classes populaires du monde agricole, qui étaient très importantes dans les années 1950-1960, les classes populaires liées au commerce, à l’artisanat, au travail indépendant et une partie importante des employés du secteur privé. C’est donc un ensemble hétérogène de différents groupes sociaux qui se reconnaissent dans la même stratégie, pour des raisons différentes.
Le bloc bourgeois a été constitué longtemps plus tard, même si cette stratégie n’a pas été inventée par Macron. C’est le projet que Jacques Delors avait en tête, lorsqu’il a renoncé à se présenter aux élections présidentielles de 1995. C’est aussi le projet sur lequel Bayrou a fait un très bon résultat en 2007. Et c’est évidemment le projet sur lequel Macron a gagné la présidentielle de 2017. L’idée fondamentale est de réunifier l’ensemble de la bourgeoisie, auparavant divisée par le clivage droite/gauche, dans un seul bloc. La réunification se fait sur un projet de modernisation du capitalisme français, c’est-à-dire de prolongement de la transition vers le modèle de capitalisme néo-libéral, de soutien à l’unification européenne et, selon la rhétorique du bloc bourgeois, sur la volonté de mener une politique raisonnable sans tomber dans les clivages politiciens. Ce bloc n’exclut pas la totalité des classes populaires mais la bourgeoisie réunifiée en forme le cœur. La partie des classes moyennes et le peu des classes populaires qui sont venus vers ce projet n’ont pas été attirés par une proposition répondant directement à leurs conditions de vie, au contraire : l’idée est que les réformes néo-libérales font mal aux classes populaires, mais permettent à terme à ceux qui se situent en bas, dans une société plus fluide, plus mobile, d’avoir une chance de monter dans la hiérarchie sociale. C’est la promesse du néo-libéralisme, et le bloc bourgeois est vraiment un bloc néo-libéral. Ce projet a été pensé pour la bourgeoisie, et ceux qui n’y appartiennent pas et ont été attirés par ce projet l’ont été car on leur a promis de pouvoir demain intégrer la bourgeoisie.
Souscrivez-vous à l’analyse selon laquelle l’électorat de Macron aux présidentielles de 2022 est réduit à l’électorat historique de la droite ?
Pas tout à fait. Ce n’est plus la même chose qu’en 2017, mais ce n’est pas non plus l’électorat traditionnel de la droite. L’électorat traditionnel de la droite s’est effondré, comme en témoigne le score de moins de 5% de Pécresse aux dernières présidentielles. Une partie est allée vers Macron, et l’autre vers l’extrême-droite. Ce que je vous ai résumé du projet de Macron en 2017 est le discours de sa campagne électorale d’alors, qui comportait aussi des promesses relatives à la démocratie, aux libertés publiques, aux droits individuels, un programme qui correspond à ce qu’on a appelé la Troisième voie.
Mais en réalité, il a très vite abandonné cette dimension présentée comme progressiste durant sa prise de pouvoir et il a gouverné dès les premiers mois en faisant reculer les libertés publiques, par exemple dans la gestion des manifestations. On peut expliquer cela par le fait que le bloc bourgeois a des fragilités internes, et c’est quelque chose que Macron sait, puisque la France est le dernier pays à connaître cette stratégie de la Troisième voie. Le premier avait été le Royaume-Uni avec Tony Blair, puis il y avait eu Bill Clinton aux États-Unis, Schröder en Allemagne, Zapatero en Espagne, Renzi en Italie. Ce projet n’a jamais tenu la route, parce que le bloc bourgeois ne tient jamais les promesses faites aux classes moyennes comme aux outsiders des classes populaires, ceux qui ne sont pas protégés par le vieux système contre lequel le bloc bourgeois veut se battre. Macron savait qu’il avait réussi à gagner en 2017 grâce à certaines promesses mais qu’il ne pourrait pas les renouveler en 2022 car personne n’y croirait. C’est pourquoi il a viré à droite sur certains principes liés à la démocratie, aux libertés, aux droits individuels et qu’il a récupéré une partie du bloc de droite. Mais il n’a pas reconstitué le bloc de droite, puisqu’une autre partie très importante de l’ancien bloc de droite a rejoint la proposition de l’extrême droite, pour des raisons très différentes qu’il faudrait analyser. On ne comprendrait pas pourquoi l’extrême droite fait 35% et pourquoi Macron ne fait pas un score de 40% dès le premier tour si on acceptait l’idée qu’il a reconstitué l’ancien bloc de droite.
Est-ce qu’on peut dresser un parallèle entre la stratégie actuelle de Glucksmann et celle du Macron de 2017 ?
D’une certaine façon oui, on peut dresser un parallèle, puisque le vieux projet de Delors, de Bayrou puis de Macron est la transition du vieux capitalisme français vers le modèle néo-libéral. Le néo-libéralisme dans sa forme pure n’est pas classable sur un axe droite/gauche, puisqu’il y a aussi dans le modèle néo-libéral l’idée d’une série de progrès en termes de liberté, d’autonomie individuelle, de droit des personnes, de contenu de la démocratie, de participation aux choix politiques. Par ailleurs, la spécificité de la démocratie française est que de larges pans des électorats à la fois de droite et de gauche s’opposent aux réformes néo-libérales. Si l’on regarde les sondages sur la dernière réforme des retraites on voit que 70% des Français et 90% des actifs s’y opposaient. Il n’a pas pu y avoir l’équivalent d’une Thatcher ou d’un Blair en France, du fait des résistances très fortes, tant dans le bloc de droite que dans le bloc de gauche. La transition française a donc été plus lente, beaucoup plus progressive, il n’y a pas eu de rupture néo-libérale brutale comme au Royaume-Uni ou en Italie.
L’idée de Macron qu’on peut retrouver chez Glucksmann est de prolonger cette transition, par exemple avec l’adhésion très forte à la perspective d’une Europe fédérale. Il est évident qu’on ne peut pas défendre cela et prolonger les réformes néo-libérales en comptant sur le soutien de l’ancien bloc de gauche. C’est pour cela qu’une alliance avec LFI est exclue. Il y a tout un discours sur la diabolisation de Mélenchon ou son soi-disant « antisémitisme », mais le vrai problème dans l’esprit de Glucksmann est que les réformes qu’il souhaite mener, la défense d’une Europe fédérale ou une réforme des retraites avec l’introduction d’un système par points ou d’une capitalisation, ne pourront pas l’être dans le cadre d’une alliance avec LFI. Il s’agit donc de reconstituer un bloc bourgeois, avec la gauche modérée et une partie du macronisme. L’un des problèmes de Glucksmann, est qu’il ne dispose pas des mêmes appuis financiers et médiatiques qui ont permis à Macron d’y aller seul en 2017. Qui pourrait imaginer Place Publique partir sans alliés à la présidentielle, ou à n’importe quelle autre élection ? Contrairement à Macron, Glucksman doit tenter de s’appuyer sur le PS. Ça le conduit à dire qu’il est de gauche, mais d’une gauche raisonnable, moderne, libérale, pro-européenne et pro-guerre. On ne voit pas exactement en quoi tout cela serait de gauche, et on ne voit pas non plus pourquoi l’alliance sociale qui n’a pas tenu six mois avec Macron fonctionnerait avec Glucksmann. Par ailleurs, c’est un autre sujet, mais si le Rassemblement national devait gouverner on verrait aussi qu’il y a des contradictions énormes dans le bloc d’extrême droite au sujet des réformes néo-libérales.
Vous venez d’aborder les possibilités de contestation. Pour autant, dans votre livre, vous n’abordez pas réellement le fait que les politiques menées ou la façon de les conduire visent parfois à éviter un mouvement social de masse.
On ne peut pas dire qu’aujourd’hui la politique de Macron vise à éviter un mouvement de contestation, on pourrait même soutenir que le passage en force est sa marque de fabrique. Le cas le plus flagrant est celui des Gilets jaunes. Le choix de Macron a été celui du refus d’une véritable interlocution, et de la répression violente. Il faut aussi souligner que l’un des facteurs qui ont permis à Macron au pouvoir de réagir de façon très brutale, est le fait que les Gilets jaunes étaient politiquement désorganisés, ce qui réduisait leur capacité de jouer sur la dynamique du soutien.
On peut prendre un autre exemple en Italie, celui du Mouvement Cinq Étoiles, qui est différent des Gilets jaunes puisque les modalités sont différentes d’un pays à l’autre, mais les types d’attentes exprimées étaient très proches, les deux mouvements avaient une part importante de spontanéité et dans les deux cas il s’agissait de mouvements qu’au moins initialement on ne pouvait pas classer comme à droite ou à gauche. Mais en Italie la réponse du pouvoir n’a pas été la répression violente, et c’est lié au fait qu’en Italie le mouvement était organisé. Je ne dis pas qu’il faut prendre Cinq Étoiles, sa structure verticale et son chef Beppe Grillo en modèle, mais le fait de s’organiser politiquement peut empêcher le pouvoir de considérer la répression violente comme la seule réponse à apporter. Évidemment, ce n’est pas la faute des Gilets jaunes s’ils ont été réprimés, c’est Macron qui est responsable, mais il y a eu une erreur stratégique dans le fait de ne pas se structurer politiquement. Il ne faut pas compter sur les principes moraux des gouvernants pour éviter la matraque, mais sur les coûts politiques que le recours à la matraque peut impliquer. Si le pouvoir considère qu’il peut réprimer un mouvement sans trop de conséquences négatives alors il le fera.
Vous pensez que si à ce moment-là les assemblées de Gilets jaunes avaient, par exemple, décidé de créer ou de soutenir une liste lors des Européennes, ça aurait pu changer la donne ?
Non, ce n’est pas le fait de participer à une élection quelconque qui change la donne. Mais par exemple, même s’il est impossible de refaire l’histoire, je crois qu’elle aurait été différente si les Gilets jaunes avaient trouvé le moyen d’avoir des porte-paroles considérés comme légitimes par l’ensemble du mouvement, ce qui n’a pas été le cas. Le risque d’une répression violente augmente quand grandit l’écart entre la puissance d’un mouvement et la faiblesse de sa direction politique. Encore une fois, la responsabilité des éborgnés est toute entière celle de Macron, mais sur un plan analytique il faut comprendre comment une répression si violente a pu être possible sans conséquences politiques majeures pour le pouvoir. Évidemment, il ne s’agit là que de l’un des éléments explicatifs, parmi lesquels il faut aussi mettre au premier plan l’énorme concentration des pouvoirs que la Cinquième République attribue au Président, et la dépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif, qui limite objectivement la possibilité de sanctions juridiques, et laisse donc croire, en grande partie à raison, au gouvernement, aux préfets et à la police que tout leur est permis.
Le mouvement des Gilets jaunes est tout de même resté très populaire auprès de l’opinion, pendant longtemps, et ce moment semble avoir eu un coût politique pour Macron…
Oui, ça a été un mouvement d‘une grande puissance. C’est cela qui était dangereux pour le pouvoir, c’est pour cela que le pouvoir a réagi, et il a pu le réprimer parce qu’il y avait une contradiction entre le fait d’être un mouvement très puissant et l’incapacité à se doter d’un encadrement, d’une direction, d’instances d’élaboration des priorités, etc. Je ne dis pas que les Gilets jaunes devaient se constituer en parti et se présenter aux élections, mais prenez l’exemple de la France insoumise. Elle subit régulièrement des attaques, mais pour l’instant le pouvoir ne s’est pas permis d’éborgner ou d’emprisonner ses représentants. Peut-être que ça changera, mais jusqu’à maintenant ils ne l’ont pas fait, bien qu’il s’agisse d’un mouvement d’opposition très fort. Parce que je pense que les conséquences en termes de soutien seraient plus douloureuses pour le pouvoir si la répression de la France insoumise était aussi violente que celle qui a frappé les Gilets jaunes.
Ce n’est pas seulement la structuration interne mais aussi les modes d’action qui ne sont pas les mêmes : Macron s’est peut-être plus senti menacé par les manifestations de Gilets jaunes qui défonçaient la porte d’un ministère et s’approchaient de l’Élysée que par les rassemblements statiques où l’on écoute les élus de la France Insoumise.
Je ne pense pas que la différence soit dans le fait que le rassemblement soit statique ou non. Si l’on est cynique, on peut se dire qu’un mouvement structuré qui a des porte-paroles permet au pouvoir d’avoir une forme d’interlocution, donc d’une certaine manière de gérer le mouvement. Les Gilets jaunes étaient peut-être moins gérables que la France Insoumise ou que les énormes manifestations pour les retraites, pour lesquelles on considère que les représentants syndicaux sont des interlocuteurs. C’est peut-être plus gérable donc moins dangereux pour le pouvoir, on peut dire cela. Mais en même temps, même si j’ai une énorme sympathie pour les Gilets jaunes, il faut quand même voir qu’un mouvement d’une telle puissance s’est terminé quasiment sans laisser de trace. Ce n’est pas très sympathique pour ceux qui ont participé aux mouvements de dire cela, mais ils n’ont obtenu que quelques petites concessions…
Oui, le retrait de la taxe sur l’essence et une augmentation de la prime d’activité, à hauteur de 100 euros pour une personne seule payée au Smic...
…Alors qu’il s’agissait d’un mouvement puissant avec des demandes très fortes sur les inégalités sociales, l’organisation du travail, le renouveau de la démocratie. Tout cela est terminé, du moins pour l’instant. On ne sait jamais, ça peut revenir, mais on ne peut pas dire qu’ils aient obtenu ce qu’ils souhaitaient. On s’éloigne un peu du thème, mais du point de vue de l’accumulation du soutien politique, réprimer un mouvement très peu organisé coûte moins cher que de réprimer un mouvement, un syndicat ou une association reconnue.
On évoque ces dernières semaines un « recentrage » de Jean-Luc Mélenchon, dont semblent témoigner le lancement d’un réseau de « chefs d’entreprise insoumis » et sa volonté de rassurer une partie du patronat. Comment cela peut-il s’analyser ?
L’Institut La Boétie a tenu un colloque avec des représentants du petit patronat le 24 janvier. Je suis moi-même membre du conseil scientifique de l’Institut La Boétie et je ne pense pas que la finalité soit celle d’un recentrage. Ça relève plutôt d’une volonté de démontrer que le programme de la France Insoumise est un programme sérieux. Si l’on prend par exemple la dimension relative à la transition énergétique, il est évident qu’on ne peut pas avoir un programme aussi ambitieux sur la production d’énergie, sur la rénovation du bâtiment, etc., et imaginer qu’il soit viable sans qu’une partie des entreprises y adhère. On ne peut pas rebâtir des secteurs entiers de l’économie française sans que des entreprises jouent le jeu. Il me semble donc que mettre ces liens en avant est une façon de dire que la France Insoumise compte réellement mettre en œuvre son programme si elle arrive au pouvoir.
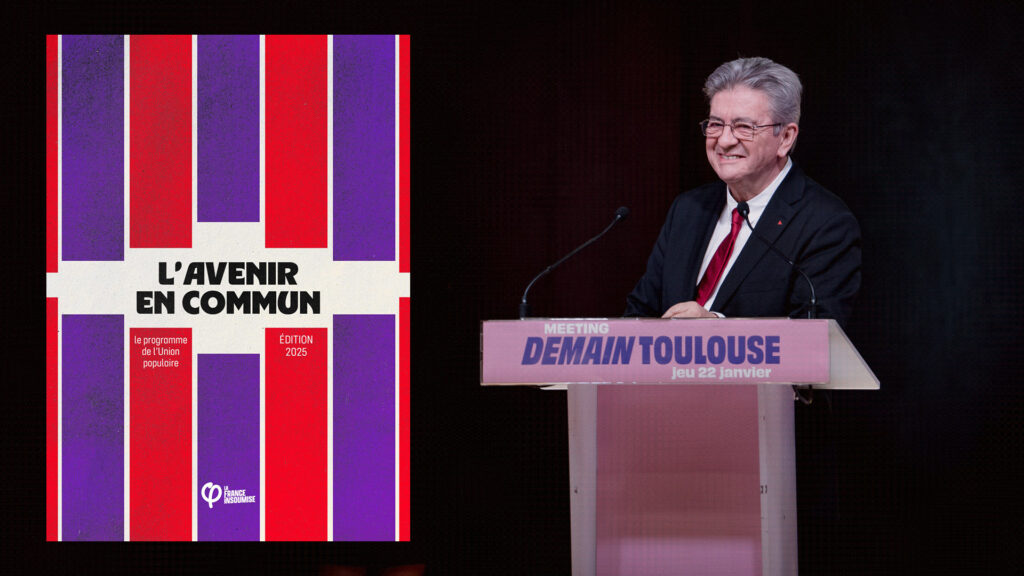
Quant au fait de parler aux petites entreprises plutôt qu’aux grandes, il y a de vraies différences, ne serait-ce que parce que les petites entreprises ne sont pas délocalisables. Et si l’on se demande s’il y a des chances d’impliquer des entrepreneurs, elles sont évidemment beaucoup plus grandes vis-à-vis des petites entreprises, à qui l’on peut promettre que le programme de la France Insoumise assurera une certaine stabilité dans leurs carnets de commandes et leurs perspectives d’activité. Les grandes entreprises regardent seulement le taux de rentabilité et elles ont l’habitude de délocaliser quand il n’est pas satisfaisant, alors que l’objectif fondamental des petites entreprises est celui de leur viabilité.
Les objectifs ne s’excluent pas, mais je me demandais initialement si le but premier de cette démarche était qu’une masse de petits patrons et d’artisans votent pour la France Insoumise, s’il s’agit d’essayer d’être traité différemment dans les médias dominants en promettant que la gauche n’est pas contre le patronat, ou si l’objectif est de limiter l’opposition du patronat en cas de victoire électorale.
Il y a une quatrième chose dont je vous ai parlé précédemment, qui est que le programme soit pris au sérieux et ne soit pas considéré comme un ensemble de promesses intenables. Montrer que le programme est sérieux et qu’il existe une volonté réelle de le mettre en œuvre est aussi une façon de tenter d’accéder au pouvoir. Pour une partie non négligeable de l’opinion, les insoumis racontent des choses étranges, irréalistes, inefficaces. Il est essentiel donc de montrer que le programme est sérieux. C’est selon moi du même ordre que l’énorme travail de la campagne de 2022 sur le chiffrage du programme. C’est pour moi l’objectif premier. Je n’exclus pas qu’il y ait aussi une dimension électoraliste, la volonté de se donner une image un peu plus consensuelle, mais je ne pense pas que ce soit l’objectif premier.
D’ailleurs, sur quoi peut-on s’appuyer pour mesurer les attentes et les motivations du vote ? Pour prendre un cas concret, comment savoir par exemple si le vote populaire pour Trump est lié à la croyance en une réindustrialisation qui va améliorer la condition ouvrière, s’il n’a d’autre but que lui-même en tant qu’expression de colère contre les Démocrates, ou s’il est lié à une volonté de voir les migrants persécutés ?
C’est une dimension politique, qui entre dans la dimension idéologique. La situation n’est pas la même en France et aux États-Unis mais les attentes des électeurs, ou plus généralement des citoyens, ne sont pas quelque chose auquel un responsable se confronte comme si c’était une donnée de nature. Les attentes sont construites. La hiérarchie entre les attentes est elle aussi construite. Est-ce qu’on donne la priorité à des attentes d’ordre économique, social, le pouvoir d’achat, le chômage, etc. ? Est-ce qu’on donne la priorité à des attentes comme la lutte contre l’insécurité et l’immigration ? Cette hiérarchie entre les attentes est le produit d’un combat idéologique, d’un combat culturel, d’un combat médiatique, d’un combat politique. Les politiques ne font pas tout, ils ne sont pas seuls dans le combat idéologique, mais l’une des dimensions d’une stratégie politique consiste à essayer d’impulser une certaine hiérarchie des attentes. Mettre certains thèmes au cœur d’un projet politique est aussi une façon d’essayer de faire en sorte que ces thèmes soient prioritaires dans les attentes de ceux qui vont voter.
C’est par exemple la bataille qu’a menée l’extrême droite pour minimiser l’importance des problèmes économiques et insister sur l’insécurité, l’immigration et l’identité nationale. C’est fondamental car un bloc social est un agrégat de blocs socio-politiques différents. Comme je l’ai indiqué, chaque groupe socio-politique est défini sur la base d’une attente partagée, ou d’un certain nombre d’attentes partagées. Le fait de jouer sur la hiérarchie des attentes modifie la composition-même des groupes socio-politiques. Si les attentes sont d’ordre socio-économique, vous aurez une certaine constellation de groupes socio-politiques. Si les attentes fondamentales sont en termes d’identité nationale, de sécurité ou de lutte contre l’immigration, alors vous aurez une autre configuration. D’autres blocs sociaux deviendront possibles. Des blocs sociaux qui sont possibles dans un contexte ne sont plus viables dans un autre. La hiérarchie des attentes est une bataille fondamentale, et c’est une bataille idéologique à laquelle les politiques participent, même s’ils ne sont pas les maîtres du jeu.
Pour prolonger
- Le moment Poulantzas de la gauche française ? (En avant Marx avec Stathis Kouvélakis et Yohann Douet, octobre 2024)
- Macron dissolution, Macron explosion ? (Aux sources avec Stefano Palombarini et Stathis Kouvélakis, juin 2024)
- Macron et son « bloc bourgeois » : la grande illusion (Aux ressources avec Bruno Amable, juin 2017)


Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.