Les raisons du succès de Chollet sont à première vue aisément reconstituables : identifiée comme féministe de gauche, elle se positionne en vulgarisatrice de toutes sortes de textes que l’époque produit sans toujours les rendre accessibles, et sa signature offre la promesse d’une lecture plaisante donnant un accès rapide à des analyses politiques émancipatrices. La séduction qu’elle opère tient à une pratique d’écriture systématiquement rapportée à son sujet d’énonciation : le « je » est présent partout dans les pages, articulant étroitement les éléments analytiques à des expériences parfois très intimes, le plus souvent simplement anecdotiques, toujours personnelles. L’autrice se signale ainsi comme une personne bien réelle, située, impliquée dans un geste d’écriture qui permet d’emporter la lecture dans une expérience d’identification très secourable à quiconque redoute les effets réputés glaçants, « désincarnés », de l’écriture savante des livres d’histoire, de sociologie ou de théorie politique…
Cette pratique d’écriture hybride, qui mêle le témoignage à l’analyse, subordonne structurellement la seconde au premier : l’enquête est menée à la faveur d’une expérience personnelle douloureuse qui opère comme déclencheur, et sa finalité n’est pas tant la recherche de la vérité et de la rigueur analytique que la « guérison », le mieux être, le soulagement de la douleur initiale. C’est en somme de la « recherche » enchâssée dans un programme de développement personnel, et tout porte à croire que cet encastrement explique une bonne part de la popularité de cette écriture : elle est parfaitement ajustée à ce que réclame l’époque, très portée sur la poursuite « éclairée » de l’épanouissement individuel.
Les maux de l’âme de Mona Chollet
La douleur qu’il s’agit chez Chollet de guérir est de nature psychique. Il ne saurait en être autrement eu égard aux conditions matérielles d’existence de l’autrice, d’ailleurs parfaitement transparente quant à sa position sociale très confortable : au moment de la rédaction de ce dernier ouvrage, elle confie être émancipée de l’aliénation salariale, ayant pu – sans doute à la faveur du succès commercial de ses précédents ouvrages (mais cela, elle ne l’écrit pas) – se délivrer de tout emploi pour se consacrer à l’écriture de ses livres. Libérée de toute contrainte, Mona Chollet est en proie à un mal qu’elle entend affronter sans faillir : la « culpabilisation », à laquelle elle entreprend de « résister » – c’est le titre de l’ouvrage : Résister à la culpabilisation.
Ce mal sournois prend la forme d’une « petite voix intérieure » qui la persécute quotidiennement en l’assaillant de reproches sur son insuffisance personnelle. Ce n’est pas une petite affaire : « une armée de démons, surgie de nulle part, s’est parachutée sur le parquet de chêne de mon studio et s’est mise à danser la sarabande autour de moi en grinçant des dents ». Déposée au creux de cette évocation fantasmagorique, la notation circonstancielle décorative, apparemment anecdotique, pose la situation d’énonciation : ce « parquet de chêne » et ce « studio », où se lisent à la fois l’aisance matérielle (la belle essence du revêtement boisé), sa mesure raisonnable (la modestie du studio) et le souci de se mettre en scène, esthétiquement et socialement. Ce qui s’exprime à travers Mona Chollet, et qui s’ouvre, auprès d’un lectorat supposé semblable, de sa hantise, c’est, de manière spectaculairement typique, la petite bourgeoisie intellectuelle.

Quelle petite voix dans « nos » têtes ?
Précisons d’emblée qu’une position sociale n’est pas une faute. C’est une position – c’est d’ailleurs aussi, objectivement, la mienne (petite bourgeoisie intellectuelle, blanche, de surcroît). Si l’on peut produire un discours critique à ce sujet, ce n’est pas sur l’appartenance à l’une ou l’autre position, mais sur l’impensé qui permet de la confondre avec une expérience universelle et universalisable du monde – impensé dont il me semble que Mona Chollet se rend coupable en évoquant à maintes reprises cette « voix dans nos têtes » : qui donc est ce « nous » de « nos » têtes ? Un scrupule intellectuel minimal aurait consisté à vérifier qu’elle résonnait pareillement, en reproches personnels incessants, par exemple dans la tête d’une femme de ménage racisée : il n’est pas certain que la tyrannie de la réalité lui laisse le loisir d’une telle « tyrannie » intérieure. Mon hypothèse est que ce « mal » est le symptôme d’une maladie sociale aisément situable : elle délimite le périmètre exact de la petite-bourgeoisie, et singulièrement de sa variante « cultivée », perpétuellement hantée par la question de sa propre innocence.
« Quelle nullité et quelle indécence de s’inventer des problèmes dans des conditions de vie aussi confortables », écrit-elle d’emblée. On pourrait s’en tenir, un peu fielleusement, à ces propos de l’autrice mimant sa propre critique dans l’introduction, et considérer que l’autrice a tout dit de son propre travail – nullité, indécence – en mobilisant cette ficelle de la rhétorique de l’innocence qui consiste à formuler soi-même sa (petite) faute, pour se montrer sans tache. Sauf que cette rhétorique de l’innocence n’est pas une forme passagère de ce livre édifiant : elle constitue en réalité son projet exclusif, sa matière première et sa vocation ultime. Le livre tout entier fonctionne comme une vaste fabrique de l’innocence à l’usage de la petite bourgeoisie.
Figures de la « hantise » occidentale
Cette position sociale restreinte n’est que très tardivement, et parcimonieusement, objectivée dans le texte, de même que son appartenance à la Blanchité occidentale. Mona Chollet entraperçoit certes que « la voix dans nos têtes » semble bien « spécifique à l’Occident », mais c’est pour la relier aussitôt à la christianisation européenne, qui aurait condamné les populations occidentales à se convaincre qu’elles n’étaient que « de vil.e.s pécheresses et pécheurs ». Ainsi repliée sur le péché originel, la faute de l’Occident se trouve rabattue sur son risible versant imaginaire (qui croit encore à ces sottises bibliques ?) et occulte cavalièrement une hypothèse qui se présentait avec la même vraisemblance, qui relierait cette faute à son histoire coloniale et à sa géopolitique impérialiste.
S’il est intellectuellement envisageable que nous soyons encore hantés par les injonctions culpabilisantes que les prédicateurs chrétiens ont infligées à nos aïeux, il n’y a rien d’insurmontable à concevoir que « hantés », nous le soyons aussi – surtout ? – par les critiques émises, aujourd’hui encore, par les protagonistes du Sud global : ceux-là ont sur les « fautes de l’Occident » passées et présentes un discours autrement consistant, et copieusement documenté. La transmission de leur discours légitimement accusateur à travers l’espace (géographique et politique) n’est pas plus improbable que la transmission à travers le temps de l’imaginaire de la faute judéo-chrétien. A l’heure de la circulation tous azimuts des discours de toutes provenances dans l’espace nébuleux de nos interactions numériques, il y a fort à parier que nous y soyons beaucoup plus exposés qu’aux lointains échos de la culpabilité chrétienne.
Pliure individualisante et psychologisation
Mais pour les percevoir, il faudrait a minima y tendre l’oreille, donc avoir pour Autrui un peu d’espace mental disponible – ce qui n’est pas, en dépit des apparences et de ses protestations indignées, le fort de la petite bourgeoisie intellectuelle blanche… Et pour savoir qu’en faire, il faudrait se déprendre de notre inclination compulsive à nous croire interpellés individuellement par les discours politiques critiques, et à transformer en faute morale personnelle des structures collectives qui passent à travers nous. Dans un article passionnant paru dans la revue académique en ligne Psy Genre Société, Pierre Niedergang (philosophe) et Salomé Mendes-Fournier (psychologue clinicienne) examinent méthodiquement cette logique d’intériorisation personnelle qui tend à dépolitiser les discours qui nous environnent : « Cette pliure individualisante conduit alors à une psychologisation qui enferme la question politique dans la moiteur d’une psyché fermée sur elle-même : croyant que l’appel s’adresse à lui en tant qu’individu, le sujet se retourne sans chercher à entraîner avec lui la structure dans laquelle il s’inscrit.[1] Les 267 pages que compte le livre de Mona Chollet font exactement cet effet d’une circulation autistique dans la moiteur d’une psyché fermée sur elle-même, intériorisant d’innombrables discours rapportés pour les métamorphoser en auto-culpabilisation morale, à laquelle sont opposés des efforts – exclusivement psychologiques puisqu’il s’agit de « résister » (mentalement) à la « culpabilisation » (imaginaire).
Dès la fin de l’introduction, la lectrice pourtant patiente que je suis est tentée de lui crier : « Sors ! ». Sors de ta tête, de chez toi, et – puisque tu dis avoir du temps, mauvaise conscience, et souci du malheur d’autrui – va ! Donne-le, ton temps, donne-le à ton syndicat (es-tu syndiquée ?), donne-le à tes collectifs militants (y traînes-tu encore quelquefois ?), organise des actions, des tractages, des manifs, des mobilisations ou même une fête de quartier, bref : articule-toi à du collectif. On n’y a pas ces problèmes de « petite voix dans la tête » – parce qu’on est environné de vraies voix avec lesquelles il faut composer pour agir ensemble. Las : on découvre en fin d’ouvrage que le collectif, ça ne va pas non plus, ça ne va pas du tout. L’autrice redoute « l’effet de vase clos des collectifs militants », qui fait « perdre de vue les objectifs politiques », et « dilapider les énergies dans des conflits de personnes et de pouvoir »[2]. Oui, c’est vrai : dans les collectifs, il y a d’autres voix que la sienne. Tandis que la vie intérieure, et le livre qui n’en est que l’expression hypertrophiée (et hyper rentable), c’est la garantie d’une scène parfaitement sécurisée où l’on sera et le sujet et l’objet, l’acteur et le spectateur, la victime et le bourreau, dans un grand dispositif spéculaire où le monde tout entier se replie en problèmes d’ego, anticipant même qu’il prête le flanc à des procès en « nombrilisme », en « narcissisme », ou en « indécence » – aussitôt désamorcés puisqu’ils sont convoqués par celle-là même qui s’en accuse.
Ventriloquie et silenciation
On a vu que la forme hybride de cette écriture subordonnant la recherche au témoignage produisait déjà un rapatriement massif de l’extériorité vers l’intériorité : d’innombrables fragments d’une vaste intertextualité aux contours indéfinissables, mêlant les publications savantes aux citations Instagram, les livres théoriques aux articles de Marie-Claire, sont ainsi aspirés vers le siphon de l’ego qui les avale à des fins d’auto-régulation psychologique. Il y a quelque chose de la centrifugeuse dans ce geste graphique, ratissant vigoureusement tout ce qui passe autour de son axe, mais pour lequel il faudrait un nouveau mot puisque le mouvement est en l’espèce toujours centripète (on épargnera à cette écriture la qualification peu flatteuse de « centripèteuse », mais en gros c’est l’idée). Au cœur de cette spirale inlassablement tournée vers son propre foyer palpite cet épuisant paradoxe : l’altérité, partout convoquée en d’innombrables citations, mentions et anecdotes rapportées, est aussitôt et constamment abolie par le même geste. L’énonciation fonctionne ici comme une immense ventriloquie : Mona Chollet parle toutes les voix rapportées dans son texte, qui finissent toujours par se confondre avec cette « petite voix dans sa tête ».
Bien sûr, cette opération n’est pas sans rapport avec une forme de silenciation d’autrui ; la chose peut sembler paradoxale puisque le geste de l’autrice consiste à porter souvent dans la lumière d’autres voix que la sienne – mais, sélectionnées toujours pour leur adéquation avec l’intention énonciative initiale (ça va de soi : on cite rarement contre soi-même), et surtout, enrôlées au service d’une auto-psychanalyse à des fins d’auto-développement personnel, ces voix ne paraissent pouvoir fonctionner autrement qu’en écho d’un ego qui en est le principe organisateur et, au fond, le seul réel émetteur. La domination exercée par l’énonciatrice consiste alors dans le fait d’avoir la parole (c’est un privilège) – et de la garder en toutes circonstances – tout en se défendant vigoureusement d’être coupable de quelque abus que ce soit.
La psyché, trésor petit-bourgeois
En quoi est-ce petit-bourgeois ? Parce que (comme le note d’ailleurs l’autrice elle-même), « les dominants se sentent très peu coupables »[3]. Du côté des puissances du capital, de la très grande bourgeoisie, on n’éprouve pas ces scrupules : on assume de jouir sans entraves, on se fabrique éventuellement au besoin une morale sur mesure, comme ses costumes – mais globalement on se fout de prouver son innocence, sans doute parce qu’on a un autre capital que l’âme.
Dans la petite-bourgeoisie au contraire, l’essentiel du capital tient dans la qualité d’âme : il importe plus que tout qu’elle soit pure, et il ne faut pas minimiser les tourments qu’endure le petit-bourgeois lorsqu’il s’éprouve coupable : « La mauvaise conscience me taraude. J’ai envie de me rouler par terre en criant : ‘Non ! Tu te trompes ! Tu ne sais pas tout ! Mon âme n’est pas pure’ » écrit ainsi Mona Chollet (c’est qu’une amie vient de l’appeler en ouvrant la conversation par cette fascinante déclaration où je ne crois pas déceler d’ironie : « J’avais envie de parler à une âme pure, alors je me suis dit que j’allais t’appeler »[4]). Le fait que l’autrice non seulement juge nécessaire de rapporter sans facétie cette déclaration de son amie lui imputant une « âme pure », mais qu’elle donne à entendre sa propre protestation intérieure, révèle l’une des mécaniques de la fabrique de l’innocence : la mise en scène de la mauvaise conscience comme preuve irréfutable de la qualité d’âme.
Innocence qualité supérieure
Le livre est donc conçu comme une grande opération de lessivage moral : Mona Chollet y entreprend de sauver son âme – elle veut pouvoir jouir de son bonheur « l’âme en paix » – et bien sûr, celle de ses lecteur.ice.s (sinon ce serait égoïste et n’aurait aucune vertu sur sa propre psyché). Le fait que ces problèmes « d’âme » ne concernent en réalité qu’un très étroit segment social – celui qui ne dispose pas de la toute puissance du capital, mais jouit du privilège de l’accès à la parole publique – n’entame en rien les prétentions universalisantes de son projet, ni non plus le remarquable succès commercial qui le récompense.
La question se pose alors de savoir pourquoi ça marche si bien : qu’est-ce qui, chez Mona Chollet, rencontre dans la petite bourgeoisie intellectuelle qui achète ses livres le sentiment de cette si intime et si délectable adéquation ? Il n’est pas impossible que ce soit en rapport avec la qualité très supérieure d’innocence que vend Chollet : cette sorte de transparence de la plume, cette honnêteté ostensiblement manifestée – les repentirs avoués, la prose comme un doux confessionnal – est redoublée d’une position existentielle assez rare, et revendiquée dans la lettre même du livre : l’autrice est une « femme sans enfant ». Loin d’être exposée comme un manque (et loin de moi l’idée de suggérer que c’en soit un), cette situation est proposée comme une position depuis laquelle elle peut écrire « avec le point de vue de l’enfant ». « Quand on n’est jamais passée soi-même du côté des parents », écrit-elle, on n’est « pas si mal placée » pour traiter le sujet. Mona Chollet écrit depuis l’enfance, donc depuis l’innocence la plus pure, la plus sublimement naïve – soit : le paradis perdu de nos psychés torturées. C’est ce qui fait sans doute le prix de son écriture, et l’infaillible rentabilité de son modèle économique.
Post Scriptum : Des camarades décoloniaux me font part d’une certaine gêne sur ce texte : s’ils partagent le diagnostic que je propose quant à la problématique de « l’innocence » après laquelle les âmes blanches courent toujours, et que l’écriture de Mona Chollet illustre singulièrement, ils regrettent que je n’aie rien dit ici de ses positions sur la Palestine, contre le racisme et l’islamophobie, positions exemplaires, exprimées sur les réseaux avec constance et courage. C’est vrai. De mon côté j’ai ressenti ce scrupule à publier un texte aussi critique sur une autrice qui, sur ces combats décisifs, n’a jamais failli. A l’heure où le débat est redoutablement polarisé, et où les positions décoloniales sont partout criminalisées, il faut saluer les allié.e.s qui ne reculent pas, et persistent même opiniâtrement. Si le scrupule ne m’a pas retenue, c’est parce que mon analyse porte exclusivement sur son dernier livre et non sur la personne qui l’a produit, et parce que je crois important que soient examinées avec rigueur les postures de la mauvaise conscience, dont les conséquences politiques ne sont pas anodines. Mais ce même scrupule m’amène à associer à ce droit à la critique ce rappel nécessaire : dans le combat antiraciste, et particulièrement pour la libération du peuple palestinien, Mona Chollet est du bon côté de la barricade.
[1] Pierre Niedergang et Salomé Mendes-Fournier, « Des hommes coupables de leurs désirs : la faute au féminisme ? », Psychologies, Genre et Société [En ligne], 1 | 2023, mis en ligne le 26 octobre 2023, consulté le 17 octobre 2024. URL : https://www.psygenresociete.org/202
[2] Mona Chollet, Résister à la culpabilisation, p.233.
[3] Mona Chollet, Op. cit, p. 15.
[4] Mona Chollet, Idem, p.246

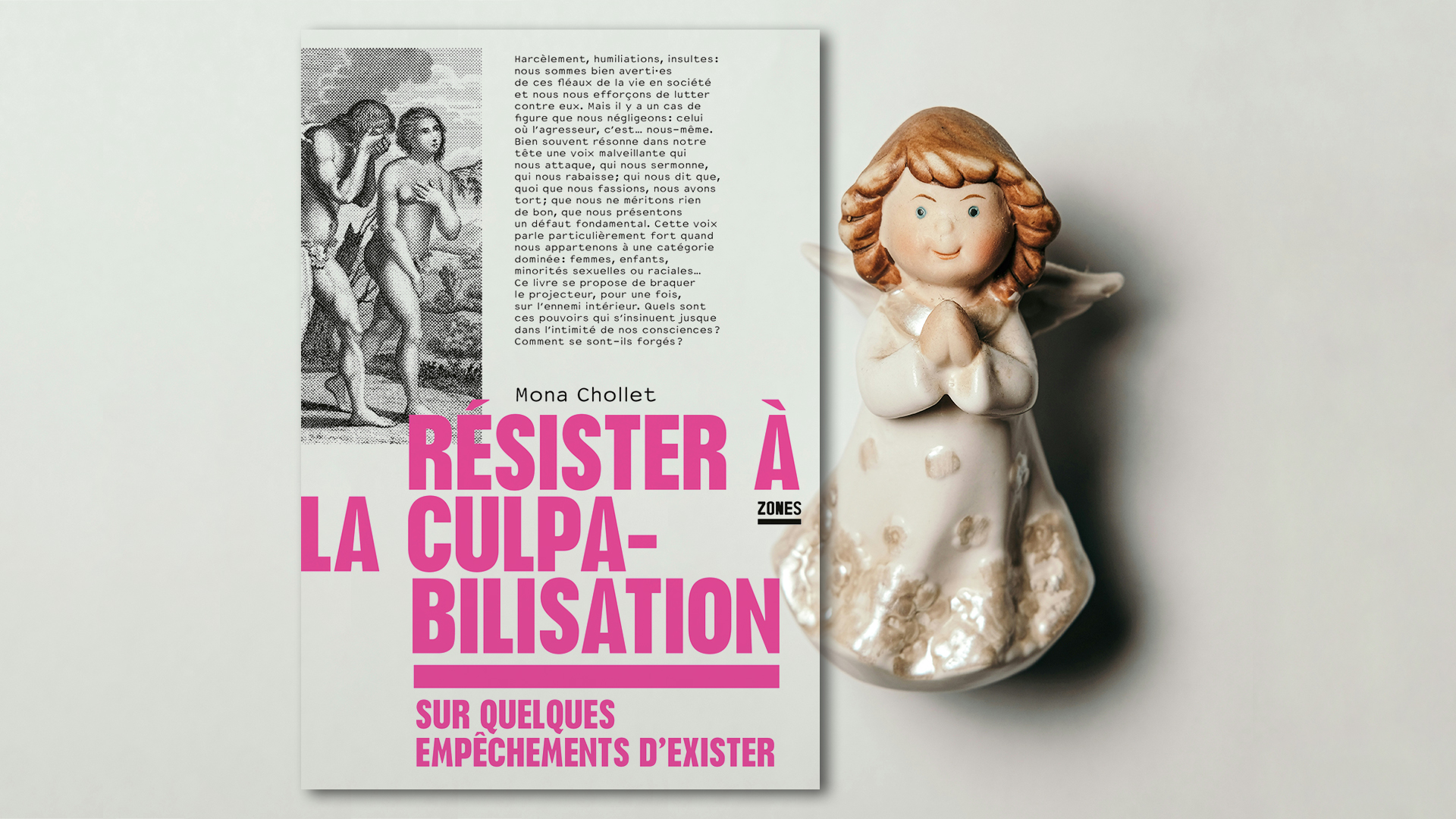
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.